Jaurès ou le pacifisme de la raison
Parmi toutes les figures politiques incarnées par Jaurès, il en est une qui se trouve une nouvelle fois aujourd’hui fortement sollicitée : l’« apôtre de la paix ». Celui qui mourut « en avant des armées », assassiné par la folie nationaliste d’un patriote perdu, eut vite les traits du pacifisme fait homme.
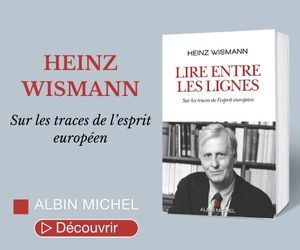
De son vivant même, l’inlassable et ardent combat qu’il mena contre les risques de guerre dans les toutes dernières années de son existence, comme l’atteste le dernier volume de ses Œuvres (1912-1914) récemment paru[1], semble être en mesure de justifier cet emploi de la grande ombre de Jaurès. Pas un jour sans que, venus de gauche ou de droite, des propos émaillés de références jaurésiennes viennent s’en prendre au soutien apporté à l’Ukraine. Le détournement d’héritage est cependant patent.
Il convient en effet d’y regarder de plus près. Derrière cette mobilisation abusive, gisent plusieurs approximations factuelles et interprétations indues voire tout à fait erronées, toutes commandées par les besoins politiques du moment. Or, à l’encontre d’un « pacifisme radical », qui n’a pas toujours bien fini dans le passé, chez Jaurès, la paix n’est jamais inconditionnelle. Comme il en va de son attachement à la nation, voire à la patrie, qui ne contredit en rien chez lui un internationalisme de grande tradition, son pacifisme ne se paie pas au prix de tous les abandons. Il y a des guerres justes, il y a des guerres nécessaires, dès lors que celles-ci sont conduites au nom de la justice.
Socialiste, héraut des grandes questions sociales, critique inspiré d’un capitalisme qu’il accuse de nourrir les guerres plus que d’établir la paix sous le régime d’un « doux commerce » auquel il ne croit pas, Jaurès n’a jamais fait des nations un opium du peuple. Il est même convaincu qu’elles offrent un cadre indispensable à la conscience ouvrière. Plus encore, comme Marx, il est attentif aux aspirations nationales, comme il pense qu’il est des « nations nécessaires » qui peuv
