Les détracteurs de la psychanalyse ont-ils un avenir ?
Nous sommes vingt ans après que le gouvernement français a introduit, à partir de 2003, par des amendements successifs, une volonté de réglementer l’exercice de la psychothérapie et de la psychanalyse.
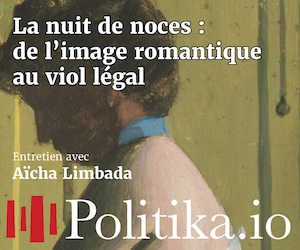
À cette époque, un vif et large débat s’était engagé dans le milieu psychanalytique et intellectuel, témoignant de l’importance et de l’enjeu crucial que représente encore aujourd’hui la psychanalyse. Qu’en est-il aujourd’hui ? Les détracteurs de la psychanalyse ont-ils un avenir ?
Aujourd’hui, la psychanalyste se réinvente, comme c’était le cas du temps de Freud et de Lacan, grâce à des psychanalystes engagé.e.s au quotidien dans leur discipline, et elle est présente dans le monde entier, dans les universités, les arts et la culture. Cependant, nous constatons qu’elle se trouve moins représentée qu’auparavant dans les hôpitaux psychiatriques et les lieux de soins, ce que nous déplorons bien évidemment.
Malgré son rayonnement en France et à l’étranger, régulièrement, la psychanalyse se trouve face à ses détracteurs en faisant l’objet d’attaques qui mettent en cause sa pertinence, son efficacité ou son actualité, avec des arguments le plus souvent polémiques et peu constructifs voire infondés conceptuellement ou cliniquement. Ces débats questionnent une certaine idée de la découverte freudienne dont on retrouve la trace dans toute l’histoire de la psychanalyse, et soulignent la nécessité d’examiner la place de la psychanalyse dans le champ social et d’interroger son épistémologie[1].
La politique de santé dans les pays occidentaux s’appuie aujourd’hui essentiellement sur les thèses organicistes légitimées par les neurosciences et sur la pratique de l’évaluation qui pose la question de l’efficacité de la psychanalyse.
Les neurosciences, le cognitivisme et le comportementalisme, en plein essor depuis ces dernières décennies, stimulés par les progrès de la génétique, relancent une idée ancienne, celle de l’opposition du psychique et du somatique. Éternel débat e
