De la xénophobie comme « pathologie de l’enveloppe »
Le jour où j’ai commencé à rédiger ce texte, cinq migrants se sont noyés en essayant de traverser le Pas-de-Calais. Cinq morts qui s’ajoutent aux dizaines de milliers qui ont péri en Méditerranée ou ailleurs en tentant de rejoindre l’Europe. Le même jour, le Parlement britannique a adopté une loi autorisant l’expulsion vers le Rwanda des migrants qui demandent l’asile. Deux semaines plus tôt, le Parlement européen avait ratifié un « Pacte sur la migration et l’asile » qui rendra encore plus difficile l’accès à la « forteresse Europe » et au statut de réfugié.
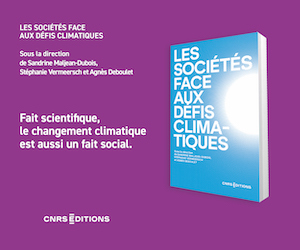
Qu’est-ce qui explique l’extension de ce dispositif d’inhospitalité dans les pays occidentaux ? Des études incontestables montrent pourtant que l’augmentation du nombre des immigrés reste très faible : seulement 65.000 par an dans notre pays[1]. D’où provient un tel décalage entre la réalité des faits et leur perception par l’opinion ? Lorsque l’on dénonce une « invasion migratoire » qui conduirait à un « grand remplacement », n’a-t-on pas affaire à un fantasme ? La xéno-phobie n’est-elle pas, comme son nom l’indique, une phobie, c’est-à-dire une pathologie psychique ?
Le recours à la psychanalyse
Pour l’éclairer, il est possible, dans un premier temps, de faire appel à la psychanalyse. On sait que les mouvements xénophobes s’en prennent aux « frontières-passoires » qui laisseraient déferler un flot de migrants. Pourquoi cette représentation trompeuse suscite-t-elle une si intense angoisse chez beaucoup de nos compatriotes ? Il se peut que l’appartenance à une nation se fonde sur le sentiment de former un corps collectif dont les individus seraient les « membres ». C’est de cette manière que les Grecs se figuraient la Cité et l’on désignait jadis le royaume comme un « corps mystique » dont le roi est la tête.
Ce qui caractérise un organisme vivant est d’abord sa clôture qui le différencie et le sépare des corps étrangers. S’il est vrai que l’identité nationale met en jeu une certaine image du corps, l
