Pourquoi publier une revue antispéciste ?
Ce printemps 2024, paraît une nouveauté, L’Amorce, au sous-titre sans équivoque : revue contre le spécisme. Sous une couverture orangée, on y trouve des articles en forme de questions : « Faut-il se fier aux intuitions spécistes ? » ou « Pourquoi la droite tient-elle tant à son verre de lait ? ». On peut aussi y lire une entrevue avec le philosophe Peter Singer, auteur du fameux Animal liberation (1975). Et qui analyse la polémique sur Sandrine Rousseau et les barbecues ? Nulle autre que l’autrice de La Politique sexuelle de la viande, l’écoféministe Carol J. Adams.
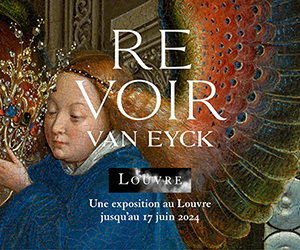
Je le sais parce que je suis co-rédactrice en chef de L’Amorce. Cette revue, en ligne depuis 2018, est le fruit d’un collectif de philosophes, sociologues, intellectuelles et militantes qui s’intéressent de près au spécisme. (Nous utilisons le féminin par défaut pour certains groupes mixtes ; c’est étrange au début, mais c’est comme pour le tofu : on s’habitue). Ce qui est nouveau ce printemps, c’est que la revue est pour la première fois publiée en un volume papier aux éditions Éliott. Voilà donc l’occasion de répondre à une question aussi simple que légitime : pourquoi publier une revue antispéciste ?
À bien y penser, je vois au moins quatre raisons.
La première raison, c’est que nous avons raison. Il existe bel et bien une oppression massive, violente et omniprésente, contre les animaux. Qui plus est, cette oppression passe largement inaperçue. Il faut donc en parler. Le spécisme, cette discrimination en fonction de l’espèce, n’est pas seulement un concept abstrait : des dizaines de milliards d’animaux terrestres (sans compter d’innombrables animaux aquatiques) sont élevés et envoyés chaque année à l’abattoir alors que l’on sait pertinemment qu’on pourrait s’en passer.
Dire, un peu crânement, je vous l’accorde, que nous avons raison, c’est dire que le spécisme existe et qu’il y a d’excellentes raisons morales de le combattre. C’est assumer son identité de revue militante. Comment rester indi
