L’art du paysage
Dans son livre Le Grand Dérangement (2021), Amitav Ghosh se demande pourquoi la littérature actuelle, au regard d’un dérèglement climatique aux manifestations alarmantes et tragiques, ne renouvelle toujours pas les régimes de représentation des événements naturels. Tempêtes, inondations, incendies, sécheresses demeurent un décor des émotions humaines, les reflétant, les amplifiant, les contrariant. Même si des auteurs et autrices, note-t-il, se trouvent par ailleurs engagés dans des luttes climatiques, cela ne touche pas les régimes narratifs de leurs œuvres de fiction. C’est qu’il est difficile de déplacer des mythes.
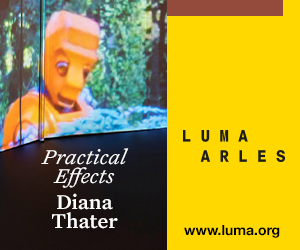
Pourtant des fictions qui intègreraient le non-humain comme agents du récit, et pas seulement comme arrière-plan romantique, aideraient à reconnaître, à visualiser, à conscientiser, un état du monde apocalyptique. La littérature, selon lui, ne saurait s’interdire plus longtemps de façonner une esthétique imprégnée de la gravité des troubles environnementaux. Qu’en est-il des arts plastiques, quand il s’agit de représenter une nature non anthropocentrée et de donner une place au vivant ?
Pas si facile de parler d’un art écologique
Cette question habite une part de la jeunesse qui opte pour les écoles de création, évitant soigneusement tout contact avec les mondes des ingénieurs. Son choix est marqué par l’intention de ne pas nuire à l’environnement, et de trouver des moyens de parer l’inhabitabilité qui menace. Dans les écoles d’art et de design les « penseurs du vivant » sont la référence qui anime leur création. Ces étudiants dont on déplorait le trop peu de lectures se sont trouvés à l’aise avec Tim Ingold, Donna Haraway, Philippe Descola, Baptiste Morizot, Vinciane Despret, Emanuele Coccia, et tout autant avec Ivan Illich, Victor Papanek et Buckminster Fuller.
Quelle esthétique prend forme à partir de cette pensée si présente auprès des jeunes plasticiens et designers ? Alors qu’on parle beaucoup, y compris dans le discours politique, de
