Le mythe de l’immunité des démocraties à l’autoritarisme
Il est haut fonctionnaire, il travaille au Parlement. Il a soutenu Macron avec enthousiasme en 2017, puis à nouveau cinq ans plus tard. En se rendant au bureau de vote, il avait peut-être moins d’allant cette seconde fois, mais il n’a pas trop hésité non plus. C’est que, « au vu des alternatives », il n’y avait « pas trop de doutes à avoir ». Le choix dans l’isoloir fut vite fait, mais restait une hésitation. Dans son esprit, ses votes répétés pour la majorité devaient constituer un barrage contre l’extrême droite. Un gouvernement allait enfin prendre les mesures qui l’empêcheraient d’accéder au pouvoir, qui la feraient reculer même.
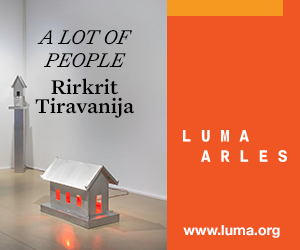
Or, non seulement le premier quinquennat n’a pas atteint cet objectif, mais la digue prend de plus en plus l’eau. Pire, il remarque que personne dans « son » camp ne semble pressé de la colmater. Il est bien placé pour le savoir. Il travaille avec des élus chaque jour, et chaque jour il voit le Rassemblement national occuper des positions de pouvoir, travailler, échanger avec la majorité « de façon tout à fait normale ».
Quand je le rencontre, à l’automne 2023, il exprime donc une gêne. Le barrage, clairement, n’a pas marché, et demain « ils » pourraient bien être au pouvoir. L’embarras est toutefois de courte durée. Pour lui, l’opposition de gauche est largement responsable de la situation. Il suffit de voir dans l’hémicycle : La France insoumise « crie », « s’agite », « insulte » quand les députés du Rassemblement national sont « calmes » et « polis ». Il poursuit, prospectif : « Et au fond, est-ce que ce serait si grave ? »
L’idée, impensable hier, s’est répandue, et cela bien au-delà du milieu politique dans lequel j’enquête. Elle a des versions différentes. Pour certains, à travers le pays et les milieux sociaux, l’extrême droite est la dernière chose qu’on n’a pas essayé, l’ultime recours d’un jeu politique auquel on ne participait déjà plus beaucoup. « Plutôt que de s’abstenir, pourquoi ne pas essayer ? », entend-on che
