Usages de l’art et arts de l’usage (1/2) – climat théorique
Une scène connue de tout professionnel·le de la culture est revisitée par une énième occurrence : lors d’une réunion de travail pour le lancement d’un projet mixte de grande envergure, mêlant action sociale, création artistique et transition environnementale[1], un débat sur la place des arts et de la culture émerge entre un collectif d’habitant·es militant·es et des associations à la pointe de la création artistique émergente.
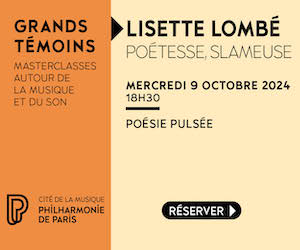
Pour ces structures, acculées à justifier leur implantation dans un quartier précaire[2] où sont déjà installés quelques équipements emblématiques de la vie culturelle marseillaise, rien d’évident à répondre à : « Les habitants n’en peuvent plus d’être sollicités pour participer à des créations, ils ont faim ! ont besoin de soins ! »
Cette séquence est, certes, une incarnation à l’extrême de serpents de mer concernant les justifications des budgets de la culture au sein de l’État ou des collectivités territoriales, un marronnier du débat sur « l’utilité de l’art » face aux besoins vitaux qui a déjà effleuré l’esprit de chacun, au moins depuis l’épidémie de Covid-19 et le classement non-essentiel de la culture. Mais lors de cette conversation, quelque chose semblait avoir changé dans l’air du temps et le classicisme des réponses d’hier avait moins cours, remplacé ou complété par de nouvelles méthodologies. Dans les équations que les acteurs culturels ont à résoudre, tenant ensemble des injonctions parfois contradictoires, entre respect de la liberté de l’artiste et transmission des œuvres, entre recherche et pédagogie, entre exigence et inconditionnalité, de nouvelles manières de faire semblaient poindre en creux des discours, révélant un léger glissement de la norme – ou un évasement de celle-ci.
Si le compromis « traditionnel » autour de la création artistique comme déploiement d’une scène symbolique en résonance mais en retrait du monde a toujours été fragile[3], il est aujourd’hui de nouveau ruminé par des mâchoires puissantes. D
