La footballisation du rugby
«Un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. » Ainsi se définissait le rugby, sport inventé dans les collèges huppés d’Angleterre et à l’origine réservé à une élite n’ayant pas besoin de tirer des revenus de ses aptitudes athlétiques. Ses règles se revendiquaient d’ailleurs d’une intelligence supérieure, banc d’épreuve d’une flexibilité cognitive hors du commun, puisque, sur le terrain, il s’agit d’être contre-intuitif : avancer en faisant des passes en arrière et cacher le ballon pour mieux le faire jaillir.
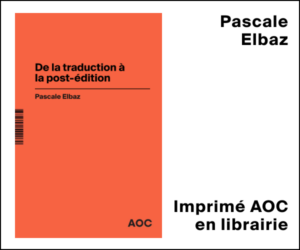
Du rugby, Jean Giraudoux prétendait qu’il était « la proportion idéale entre les hommes », une équipe se composant de « huit joueurs forts et actifs, deux légers et rusés, quatre grands et rapides et un dernier, modèle de flegme et de sang-froid ».
Le rugby, c’était « un style », selon le mot de Jean Lacouture, ou plutôt des styles : noble en Angleterre, flamboyant en Nouvelle-Zélande, combatif en Irlande, sempervirent au Pays de Galles, loyal en Argentine, créatif en France. Chaque terroir avait son cachet : on était élégant à Agen et rugueux à Béziers. Car, au gré de conquêtes de territoires parfois inattendues, la géographie d’Ovalie – la Terre du rugby, par analogie avec la forme du ballon – avait épousé des contours baroques : d’anciennes colonies de l’Empire britannique, mais pas toutes – les Maoris excellent, les Indiens méprisent ; l’Argentine ; l’Italie ; le Portugal ; la Géorgie ; et, par un curieux phénomène restant à éclaircir, le sud de la Loire, en particulier le sud-ouest, dont les fêtes ont pourtant peu d’affinités culturelles avec les garden-parties de Sa Majesté.
La notion de désintéressement, officiellement érigée en vertu, fut défendue contre vents et marées durant un siècle. Au vrai, cet amateurisme était marron, comme pour mieux s’accorder à ceux qu’on se distribuait gaiement avant, pendant et après les rencontres. La tartuferie prit fin en 1995, année où l’International Board autorisa « toutes les formes de paiement, à tous l
