Aldo Moro, les sciences sociales et les extraterrestres
Il faut parfois aller chercher dans la littérature de bonnes intuitions sociologiques. Par exemple, les sciences sociales trouveraient dans le roman OVNI 78 de Wu Ming, qui mêle chasse aux ovnis, disparitions inquiétantes de scouts et enlèvement d’Aldo Moro[1], un bon objet pour aiguiser leur regard sur les complotismes contemporains.
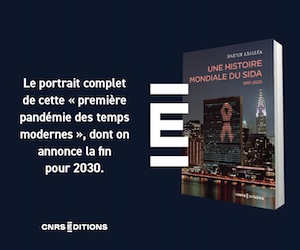
Commençons par une description factuelle – dans la mesure du possible : OVNI 78 est d’abord un roman historique, qui se déroule du 1er mars au 24 mai 1978 en Italie, au moment donc de l’enlèvement et de la mort d’Aldo Moro, dans les mondes « ufologues »[2], organisés autour de l’intérêt pour le signalement d’ovnis. Ce contexte de trouble politique intense est la toile de fond d’un récit d’enquête, autour de la disparition de deux scouts dans une montagne, qui se déploie dans des espaces pas tellement mystérieux, mais disons « mystérogènes ». C’est dans ce cadre qu’on suit Milena, anthropologue qui enquête sur les chasseurs d’ovnis, Zanka, écrivain ex-communiste de romans ésotériques à succès, et son fils Vincenzo, ex-toxicomane installé dans une communauté spirituelle appelée Thanur.
Que l’arc narratif principal, tout autant qu’il est un prétexte pour présenter de riches personnages secondaires et des paradéveloppements, soit celui d’une enquête, avec des fausses pistes, des indices, des retournements de situation, n’est pas un hasard. Wu Ming est un collectif littéraire et politique italien né à Bologne, dans les années 2000, que la passion pour les mythes contemporains, les falsifications et les cultures populaires a mené à de nombreux hauts faits[3]. Pourtant, sa notoriété est probablement d’abord liée au fait que l’un de ses premiers romans, appelé Q et paru en 1999[4] aurait « accidentellement » inspiré les premiers messages du Q de Qanon, sur 4chan, à l’automne 2017.
Chez Wu Ming, tout est à tiroir : cet ouvrage de fiction historique est entièrement organisé autour de la question de la distinction, ou, au contraire, de
