Qui tuera Liberty Valance ? Du western classique à la réalité du Far East européen
En 1962, John Ford porte à l’écran son film-testament, adapté d’une courte nouvelle de Dorothy M. Johnson, L’Homme qui tua Liberty Valance, publiée initialement en 1949. Dans ce film emblématique du western classique américain, la scène d’ouverture commence par l’arrivée du sénateur Ransom Stoddard dans la petite ville de Shinbone.
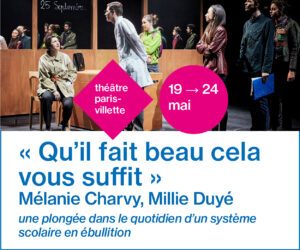
Venu de Washington pour assister à l’enterrement de Tom Doniphon, un poor lonesone cow-boy qui, jadis, l’avait sauvé de la brutalité d’un hors-la-loi, Liberty Valance, il raconte aux journalistes locaux comment il a pu en débarrasser la ville, être investi héros de l’ordre américain jusqu’à gravir les échelons qui le destineront aux plus hautes fonctions politiques.
Dans cette fable morale, la cruauté sans limite de Liberty Valance n’est pas isolée ni gratuite. Elle sert les intérêts des grands propriétaires terriens soucieux de garder la plaine ouverte à leurs troupeaux, contre la volonté de ceux qui, petits propriétaires ou commerçants, sont favorables à l’entrée de leur territoire dans une fédération qui leur garantirait l’effectivité d’un ordre légal qu’ils espèrent protecteur. Trois forces s’opposent ici : Ransom Stoddard, empli des idéaux du jeune avocat, transportant ses manuels de droit dans la wilderness américaine; Liberty Valance, dont la brutalité sans limite sert des intérêts criminels politiques et économiques clairement identifiés et qui, dans le tout premier temps de l’analepse, détrousse la diligence de Stoddard en s’acharnant à en déchirer les livres ; et enfin Tom Doniphon, fort-en-colt opposé à Valance, et supplétif officieux d’un shérif peureux et lâche.
Le Far West est-il toujours l’ailleurs de l’Europe ?
Voir ou revoir ce western depuis l’agression à grande échelle de l’Ukraine par la Russie nous a invité, depuis Paris et Kyiv, à transposer cette fable à la situation actuelle du continent européen. Car dans la parole politique occidentale qui s’offusque de certains troubles à l’ordre public interne, nous e
