La valeur est de retour
« Sur 1 000 aventuriers qui se lancent à la recherche de l’or, un seul en trouvera ; mais si l’or vaut tant, c’est que, pour le trouver, il y a le travail de celui qui le trouve et aussi celui des 999 qui n’en trouvent pas[1]. »
— John Huston
On peut se réjouir que la question de la valeur, évacuée par la théorie néoclassique depuis plus d’un siècle, revienne dans le débat académique, et mieux encore dans le débat public. Depuis plusieurs années, ouvrages et articles témoignent de ce renouveau, notamment L’Empire de la valeur (2011) d’André Orléan, La Richesse, la valeur et l’inestimable (2013) et En quête de valeur(s) (2024) de Jean-Marie Harribey, Des valeurs (2017) et La Valeur des personnes (2022) de Nathalie Heinich, Théorie délibérative de la valeur (2024) d’Éric Dacheux et Daniel Goujon[2]. Ces deux derniers auteurs viennent de présenter leur thèse dans l’article « Dénaturaliser la valeur économique en démocratie », paru dans les colonnes d’AOC.
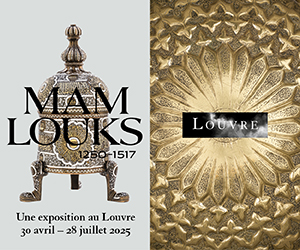
Le renouveau théorique est d’autant plus justifié que le monde capitaliste est traversé d’une crise systémique aux dimensions sociale et écologique imbriquées qui interroge de manière nouvelle l’obligation capitaliste de produire toujours plus de valeur économique au détriment du respect des valeurs sociales, philosophiques, éthiques et politiques.
Nous voudrions montrer ici que toutes ces tentatives ont certes raison de s’inscrire en faux contre la pseudo-théorie de la valeur néoclassique parce que celle-ci n’a en réalité que l’apparence d’une théorie de la valeur, mais elles s’opposent entre elles quant à l’élaboration d’une théorie socio-économique de la valeur. Pour le dire vite, un des enjeux principaux de la discussion tourne autour de savoir si la théorie de la valeur de Marx, qui puise partiellement dans l’économie politique, est recevable ou bien s’il faut lui substituer une autre approche capable de prendre en considération la globalité de la réalité sociale.
Une réalité sociale qui s’inscrit à l’i
