Sale temps pour le patrimoine de l’humanité
Le constat est désormais bien partagé : depuis quelques mois, l’exécutif étasunien bouscule tout sur son passage, des alliances géopolitiques à l’aide humanitaire, du droit international aux règles commerciales, des droits humains à la liberté académique, en passant par les efforts visant à faire face à la crise environnementale. Un feu d’artifice macabre qui peine à susciter des réactions globales allant au-delà des mots, quand il ne laisse pas pantois les organisations intergouvernementales et les collectifs citoyens et professionnels.
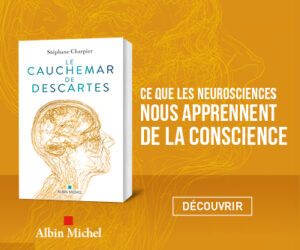
Certes, l’administration Trump n’est pas la seule responsable de la révolution réactionnaire et négationniste qui embrase le monde ; mais en quelques mois, sa puissance d’action a donné une tout autre ampleur à chacune de ces crises, et l’on peine encore à en construire une analyse d’ensemble.
Pourtant, il semble bien qu’au-delà des cibles qui sont explicitement visées par telle ou telle mesure, ce soient des valeurs sur lesquelles s’est construit le système onusien qu’il est question. Certes ces valeurs ne constituent pas un ensemble parfaitement cohérent, au-delà de la promotion de la paix et de la croyance dans les vertus du droit international et des négociations pour en arrêter les termes. Mais, à un autre niveau, il est une notion largement présente dans la phraséologie de nombreux organes onusiens qui, sous le vacarme assourdissant de déclarations tous azimuts, semble attaquée de toutes parts : celle de « patrimoine de l’humanité ».
L’existence d’un tel patrimoine est invoquée dans quantité de textes onusiens – déclarations, recommandations et traités internationaux – pour qualifier des choses aussi diverses que les droits de l’homme, le génome humain, les fonds océaniques, les ressources des corps célestes, la diversité culturelle ou encore des sites naturels et des traditions vivantes. On pourrait n’y voir qu’une forme d’incantation destinée à donner sens, tout en la justifiant, à l’action de ces organisations. Po
