Quand l’obsession migratoire transforme l’État et les frontières
La Grande-Bretagne met en place le système Terminus, un réseau de caméras de surveillance dans les communes entre Calais et Berck-sur-Mer destiné à repérer et dissuader l’activité des passeurs. Les images doivent, à terme, être centralisées dans un centre de contrôle établi à Douai. Le système Terminus n’est qu’un exemple des investissements financés par le gouvernement britannique dans la région. En 2014, face à l’afflux de migrants et la menace de la municipalité de Calais de fermer le port, les autorités versent 12 millions de livres sterling. Puis survient l’épisode de la Jungle de Calais (2015-2016) et plus récemment les traversées des small boats. Au total, les pouvoirs publics britanniques auront versé près de 200 millions de livres sterling pour renforcer les contrôles. L’afflux d’argent transforme radicalement le paysage de la frontière : érection de murs grillagés, achat de caméras de surveillance, de détecteurs de CO2, de radars infrarouges, de drones, etc.
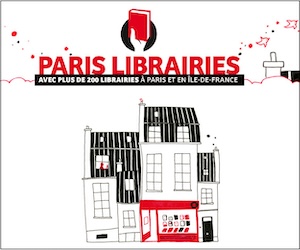
Le 29 septembre 2024, à Mulhouse un ancien procureur azerbaïdjanais et opposant au président Aliev, meurt lardé de 20 coups de couteau. Vidadi Isgandarli avait obtenu l’asile politique en France en 2018. C’est le deuxième opposant à être visé en France et le quatrième en Europe. L’enquête montre l’implication d’un réseau mafieux, Vory v Zakone, petites mains des basses œuvres des autorités dans le Caucase et en Russie et au-delà dans les pays européens.
Ces deux vignettes illustrent la propension croissante des États à agir au-delà de leurs frontières pour cibler des personnes en migration. L’action de la Grande-Bretagne sur la côte d’Opale constitue un exemple d’externalisation des contrôles migratoires, c’est-à-dire la tendance à reporter sur un État voisin le travail de contrôle des flux de personnes. L’Union européenne l’a érigé en axe directeur de sa politique migratoire au fil des décennies, d’abord en accordant des prébendes financières ou politiques aux États qui acceptent de reprendr
