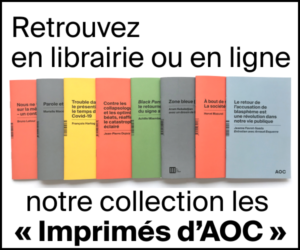Une question de style. À propos des relations entre littérature et sciences sociales
Dans la critique du roman d’Aurélien Bellanger, Les Derniers jours du Parti socialiste, parue dans AOC, les politistes Philippe Corcuff et Haoues Seniguer ont exprimé leur embarras face à une fiction qui s’empare de thèmes sur lesquels ils publient des travaux de recherche depuis plusieurs années.
Cette situation de frottement entre littérature et sciences sociales n’est pas neuve. Elle a déjà engendré nombre de débats et de controverses, exacerbées dans le cas du traitement des évènements relatifs à la seconde guerre mondiale et à la Shoah. Les Bienveillantes de Jonathan Littell, Jan Karski de Yannick Haenel ou encore L’Ordre du jour d’Éric Vuillard ont ainsi suscité les foudres de certains chercheurs, à commencer par les historiens.
Les publications des écrivains, qui se placent le long d’une frontière qu’ils franchissent et qu’ils brouillent, suscitent invariablement une série de réflexions sur ce qui différencie littérature et sciences sociales, sur ce qu’elles peuvent s’apporter mutuellement lorsqu’elles abordent des objets a priori similaires. Le plus souvent, les discussions aboutissent à une « ritournelle » des deux vérités, l’une littéraire et l’autre scientifique[1].
L’article « Les sciences sociales face à un roman » n’échappe pas à la loi du genre en proposant de distinguer vérité fictionnelle et vérité scientifique et en accordant au romancier une « liberté » dans l’usage du faux qui est refusée au sociologue. Le tracé d’un partage restaurant la clarté de part et d’autre de la frontière brouillée ne suffit pourtant pas aux auteurs pour conclure que le roman d’Aurélien Bellanger et leurs travaux disent la même chose de manière différente. Selon Philippe Corcuff et Haoues Seniguer, quelque chose résiste, quelque chose s’échappe dans le récit, une défaillance émerge, qui a à voir avec la façon dont la narration met en scène l’objet commun aux travaux et au récit des uns et des autres, à savoir la montée du conservatisme à gauche. À la réalité de ce phénom