Au Portugal, la honte court comme le feu
Le brasier à foyers multiples fut d’une telle violence que son panache de fumée assombrit jusqu’au ciel breton. De mémoire de sapeur-pompier ibérique on n’avait jamais vu ça : des feux « à comportement anormal », se propageant à une vitesse folle et résistant aux moyens d’extinction. 500 000 hectares carbonisés en Espagne, 300 000 au Portugal, soit 3 % de son territoire continental. Des parcs nationaux ravagés, une faune sauvage et des troupeaux décimés, des villages entiers évacués, certains sauvés in extremis.
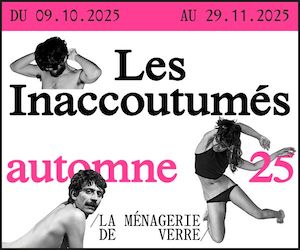
Au café, chez le coiffeur, il n’était plus qu’un sujet de conversation, chacun gardant un œil sur le site Fogos.pt qui suit en temps réel et de façon ultra précise l’évolution de tous les incendies déclarés dans le pays. Et à la télévision, omniprésente dans la société portugaise, les flammes envahissaient l’écran. Partout des envoyés spéciaux expliquant, à grand renfort de bandeaux d’information en continu, que les pompiers tentaient de circonscrire le feu. Commentaire purement tautologique. Le degré zéro du journalisme.
Les Portugais, à qui l’on tendait un micro pour s’enquérir de leurs nuits sans sommeil alors qu’il en va en réalité de leur vie, avaient pourtant des choses à dire. Chaque année ils se sentent un peu plus abandonnés. Les moyens manquent. Certaines associations de pompiers volontaires en sont réduites à organiser des opérations solidaires pour pouvoir acquérir un nouveau véhicule. Une désorganisation de la protection civile est constatée. Étrange époque que celle du principe de précaution et en même temps de la non-préparation.
Comme Macron aux premières heures de la pandémie, le Premier ministre portugais Montenegro utilisait la métaphore de la « guerre ». Et, puisque pour mener une guerre, il faut un ennemi, les pyromanes étaient tout désignés. Un quart des incendies serait d’origine criminelle. On parle d’alourdir les peines : toujours les mêmes réponses aux mauvaises questions. Mais ne ressent la braise que celui qui a le pied
