Bonaparte ou Napoléon ?
Éclatante dans son marbre blanc, la sculpture aura été l’ambassadrice d’une ambition conquérante. Le jeune général Bonaparte en avait confié la réalisation, en mai 1797, au professeur de l’Académie de Brera, Giuseppe Franchi (1731-1806). Une commande officieuse faite pour créer un mouvement d’opinion favorable à Genève. Concrètement, il s’agit de préparer la visite que le chef de l’armée d’Italie y fera le 21 novembre. Une journée au cours de laquelle le portrait fut plusieurs fois acclamé.
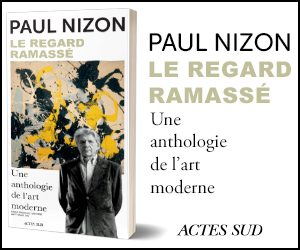
Cinq mois plus tard, occupée par les troupes du Directoire, Genève perdait son indépendance. Le buste avait rempli sa mission. « Ambassadeur muet » du nouveau pouvoir[1], il avait joué le rôle d’une sorte de cheval de Troie. Ce qui sera salué par sa longue présence publique, d’abord dans la bibliothèque municipale puis, la ville devenue française, dans ce qui était devenu la préfecture du département du Léman.
Vendue au lendemain de la chute de l’Empire, l’œuvre de Franchi a disparu pendant près de deux siècles. Réapparue, il y a quelques mois, chez Sotheby’s à Londres, elle vient d’être acquise, le 5 juillet 2022, pour 220 000 euros. Une enchère jugée avec sévérité par certains marchands d’art français. Le portrait, parce que de style néo-classique, serait peu ressemblant. L’un de ces marchands avance même que « les grands collectionneurs de Napoléon aiment les portraits plus esthétiques. Celui-là ne vaut que par le caractère historique de sa découverte[2] ». D’où une question : qu’est-ce que ressembler pour un portrait ? Se montrer fidèle à son objet ou à sa légende, aux traits du visage ou au cahier des charges du commanditaire ?
Bonaparte doit-il ressembler à Napoléon ?
Pour la théorie de l’art, le débat est classique[3]. Un portrait, qu’il soit dessiné, sculpté ou peint, rend compte d’une mise en scène. Il vise à rendre semblable (simile), sinon vraisemblable, nullement à être identique[4]. Avec le général français, l’opération se révèle redoutable. D’abord, parce
