Pourquoi il faut avoir peur des megafires
Le grand incendie de forêt est un « fait total », indissolublement social et naturel : big fire, megafire, feu extrême, LFF (large forest fire), hyper feu, « The Beast », ce sont des feux catastrophiques, ces dernières années en témoignent, dont l’ampleur, en termes d’étendue, de violence, de température, d’extension, de conséquences humaines ou de récurrence, est très supérieure à ce qui se produisait dans le passé.
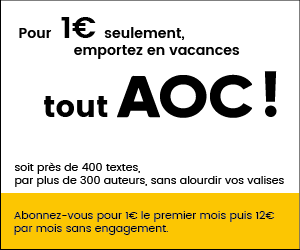
En 2017, le Groenland a brûlé. Des plaines enneigées ont pris feu. Cet été, c’est le tour de la Suède. Toutes les forêts d’Europe du Nord, victimes de pics de chaleur couplés à une longue sécheresse et à des vents erratiques, sont exposées. Les feux qui consument aussi la Californie, qui connaît les plus grands incendies de son histoire, la Grèce, l’Australie, ne sont pas habituels. Les témoins expriment un sentiment de jamais vu.
C’est pour nommer le caractère inédit du phénomène que le terme « megafire » est apparu et a commencé à s’imposer. Son auteur, Jerry Williams, qui fut responsable du service des forêts américain, observe que, même si ce terme n’est pas clair et qu’il n’y a pas de consensus sur ce que qualifie « mega », il met en exergue le fait que les grands feux ont un « comportement » que les spécialistes n’ont jamais observé dans le passé et qui, en outre, ne cesse de se modifier : « le phénomène semble se réinventer sans cesse de lui-même et se refermer sur nous, en même temps que nous luttons pour le définir. » Selon Edward Struzik, il pourrait « reconfigurer les écosystèmes que sont la forêt et la toundra d’une manière que les scientifiques ne comprennent pas vraiment. ». Selon lui, il est probable que les forêts d’Amérique du Nord changent de nature, que les industries ferment, que les eaux soient polluées, que des villes entières soient déplacées.
Le degré de gravité de ces feux atteint celui des tsunamis, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre. Pourtant alors qu’un être humain ne peut déclencher aucun de ces phénomènes
