Comme un pied-de-nez – sur Langages de vérité de Salman Rushdie
Langages de vérité a paru cet automne, après l’annonce du Nobel de littérature (que Rushdie n’a pas obtenu, faut-il le rappeler…), dans une traduction (excellente traduction, il faudra y revenir) de Gérard Meudal, et quelques mois avant la parution de Victory City, son prochain roman. Deux ou trois impressions fortes dominent. La première s’apparenterait presque à une forme de berlue : on avait quitté un Rushdie ayant perdu, aux dernières nouvelles, un œil et l’usage de sa main et on le retrouve virevoltant comme jamais et débordant de santé. Le dernier article du recueil, « Pandémie », évoque même son combat victorieux contre la Covid19.
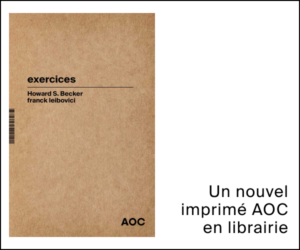
Un instant, on s’interroge. Serait-ce que l’odieux attentat perpétré en août dernier par un fou de Dieu, de Khomeiny et de sa fatwa, n’a jamais eu lieu ? S’était-il donc déroulé dans un univers parallèle, qui n’aurait jamais existé ailleurs que dans la tête dérangée d’islamistes rêvant depuis toujours de lui régler son compte ? Très vite, on déchante : le réalisme magique peut beaucoup, mais il ne peut pas faire qu’un bras armé d’un couteau ne frappe pas sa cible, dans la vraie vie. Mais le timing de cette parution intervenant plus d’un an après la sortie du volume en langue anglaise, fait quand même très bien les choses, en nous donnant l’occasion de (re)penser à Rushdie.
Penser, nous explique en substance Frédéric Worms, c’est sinon toujours, du moins le plus souvent, « penser à quelqu’un »[1]. « Avec » ce quelqu’un qui souffre dans sa chair, et qui souffre parce qu’il écrit, et à qui je pense, le sens du verbe « penser » s’éclaire et s’enrichit. Rushdie le libre penseur, se pique de penser la littérature, de penser la peinture. Penser aux histoires qui existaient déjà avant qu’il y ait des livres, c’est penser à « l’artiste composite », l’anonyme auteur du Hamzanama. La fonction fabulatrice, consistant à « créer des personnages dont nous nous racontons à nous-mêmes l’histoire » (Bergson) n’empêche nullement Rushdie de
