Gouverner, c’est pleurer ?
Le spectacle d’Emmanuel Macron laissant, selon l’expression consacrée, « éclater sa joie » lors de la victoire de la France en Coupe du monde invite à interroger les normes qui encadrent l’expressivité présidentielle, et plus généralement l’expressivité en politique. Les images de Moscou sont à rapprocher de celles, strictement inverses, qui ont ponctué les cérémonies les plus sombres des derniers mois : hommage aux victimes des attentats bien sûr, mais aussi cérémonie-hommage à Johnny Halliday et à Jean d’Ormesson. « Visiblement ému », « au bord des larmes » selon les observateurs, le président sut mettre en mots un chagrin qu’il disait partager et même ressentir au moment-même où il s’exprimait, mais qu’il parvenait à contenir : pas de larmes présidentielles, une retenue synonyme de « dignité », une émotion qui se déplace du corps vers le discours. Au regard de cette retenue typique des contextes fortement ritualisés, l’expressivité footballistique du président agitant les bras, sautillant sur son banc, ne tenant pas en place au point de suivre le match debout, interroge sur le droit aux émotions au sommet de l’État.
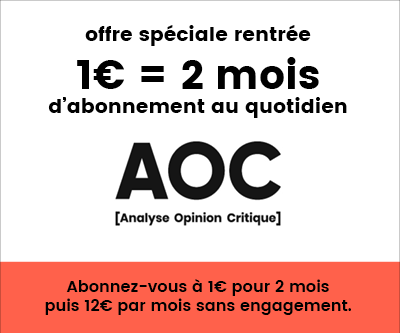
On peut défendre l’hypothèse, simple, selon laquelle le chef d’État, en contexte hyper-médiatisé, remplit une fonction de prescription émotionnelle qui enrichit la problématique classique de l’incarnation et de la représentativité. Il a pour obligation de définir un jeu serré d’émotions exemplaires qui participent du cadrage de la réalité : de quoi faut-il se réjouir ? s’indigner ? sourire ? Cette fonction de prescription émotionnelle s’appuie cependant davantage sur le discours que sur le corps : le chef d’État dit ce que chacun peut (doit ?) ressentir, mais lui-même se contrôle parfaitement.
L’histoire longue du second corps politique du roi, celui qui figure l’institution en sa majesté la plus noble, a sédimenté la figure du gouvernant parfaitement maître de ses émotions. Empruntant à l’idéal stoïcien et à l’idée qu’on doit se gouverner soi-même p
