Bye Bye Binary : « Une typographie inclusive ou non-binaire est un engagement politique »
La collective franco-belge de graphistes, typographes et artistes Bye Bye Binary est composée de 26 membres[1] à ce jour. Cette communauté militante se distingue par ses expérimentations formelles et pédagogiques autour de la question du genre dans le graphisme et la typographie. Créée à la faveur d’un workshop entre La Cambre et l’ERG, deux écoles bruxelloises, Bye Bye Binary explore de nouvelles formes graphiques et typographiques pour la langue française à partir des écritures inclusives et non-binaires. Car même si l’on voit fleurir de plus en plus de textes faisant usage de ce langage, qu’il est régulièrement utilisé dans différents milieux, il est pourtant toujours rejeté en France pour les textes officiels, allant jusqu’à une proposition de loi de 2022 visant carrément à le faire interdire.
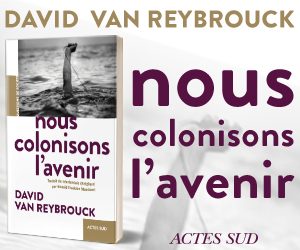
Pourquoi empêche-t-on le foisonnement de nouvelles formes d’écriture ? L’heure est-elle venue de considérer les métamorphoses des langues qualifiées de vivantes ?
Nous avons échangé avec Camille°Circlude, Enz@ Le Garrec et H·Alix Sanyas (Mourrier), trois membres de la collective, sur les enjeux des langages inclusifs et non-binaires, leurs histoires, leurs tactiques mais aussi sur les créations de Bye Bye Binary, qui se revendiquent de l’esthétique queer, du style « Camp » théorisé par Susan Sontag et qui sont, « à l’image des personnes qui les fabriquent », « molles et dégoulinantes ». Elles font l’objet d’une exposition au CAC Brétigny, le centre d’art contemporain de Brétigny-sur-Orge (91) jusqu’au 1er avril prochain. Intitulée Læ collectiv·f·e, sous le commissariat de Céline Poulin, spécialiste des pratiques de co-création, l’exposition présente les productions de cette alliance engagée, animée par l’amour, la revanche et la rage. OR
Je crois que c’est Monique Wittig l’une des premières qui, dès les années 1960, avait écrit son livre L’opoponax avec le pronom indéfini on et donc sans marque de genre. Que s’est-il passé depuis ?
H·Alix Sanyas (Mourrier) : Dans
