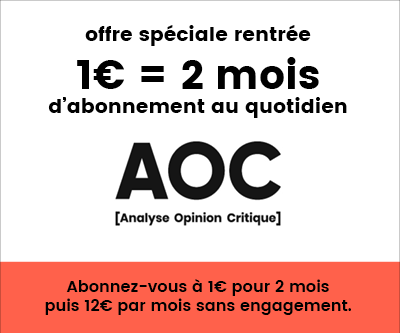Faut-il critiquer l’œnologie ?
À l’image du monde agricole, le secteur vitivinicole a enregistré de profondes mutations au fil des dernières décennies. Et comme une grande partie de l’agro-alimentaire, la filière est passée progressivement sous l’emprise de la grande distribution et des marchés internationaux. Ces évidences troublent l’image idéalisée du « vigneron », artisan perpétuant la tradition, défendant son terroir, au contact d’une nature préservée, œuvrant manuellement à la vigne et au chai. Elles invitent à analyser les transformations qui ont conduit à faire de cette filière une des plus grosses consommatrices de produits phytosanitaires [1] (fongicides, herbicides, insecticides). Des scandales sanitaires récents [2] ainsi que les images de viticulteurs harnachés sur leur tracteur en raison de la toxicité des traitements chimiques employés soulignent aujourd’hui les tolérances coupables de la viticulture « conventionnelle ».
De nombreux acteurs de cette filière se sont pourtant très tôt engagés dans des démarches respectueuses de l’environnement en optant pour une agriculture « raisonnée » (certification Terra vitis), en engageant des démarches environnementales (certification HVE – Haute Valeur Environnementale), en se tournant vers l’agriculture biologique (identifiable au moyen du label BIO), voire en évoluant vers la biodynamie (certification Demeter ou Biodyvin) ou vers une production de vins « nature » ou SAINS [3]. Ces démarches vertueuses, diversement mises en visibilité, livrent une image trompeuse de la production dans sa globalité puisqu’elles restent peu représentatives malgré leur développement croissant. Certaines dissimulent aussi des pratiques moins naturelles qu’on ne l’imagine. Le recours à des traitements massifs à base de cuivre n’est pas de nature à améliorer la qualité des sols. Quant aux intrants et aux levures tolérés dans l’élaboration des vins BIO [4], ils suscitent également la perplexité. Bref, la situation est pour le moins confuse.
Le consommate