Par-delà la manifestation, la danse comme tramage
Les comptes-rendus des manifestations françaises actuelles ne sont majoritairement dans les médias suisses, pays où je vis actuellement, que des analyses peu engageantes d’un voisin préoccupé par la crise en cours derrière sa frontière. Mais ce matin, un article m’interpelle, et je déroge à mon refus habituel de lire la presse suisse sur ce sujet. Son titre ? « La danse, la musique et la fête, nouveaux outils de contestation en France[1] ? »
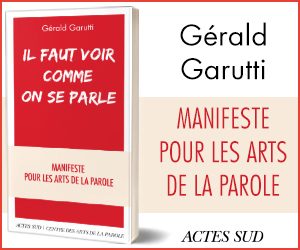
L’article s’intéresse aux chorégraphies de Mathilde Caillard, militante, membre du mouvement écologiste Alternatiba et assistante parlementaire LFI. Dans une vidéo[2], tournée dans le cadre du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, Mathilde danse sur de la musique techno au son du slogan : « Pas de retraités, sur une planète brûlée… Retraite, climat, même combat ! »
La techno-gréviste connaît le succès sur les réseaux sociaux, et le lot d’avis divergents qui viennent avec. L’article révèle ainsi que si certain·es internautes apprécient l’énergie, d’autres déplorent un manque de sérieux, allant même jusqu’à évoquer une décrédibilisation de la lutte. L’article partage, très brièvement les revendications de la première concernée sur le corps comme outil de lutte, nomme d’autres chants et chorégraphies scandés durant ces manifestations, et rapporte les propos d’un historien qui souligne comment les chants et l’esprit festif animaient déjà la période révolutionnaire. Mais, si « la chanson est alors un mode d’expression pris très au sérieux », pour la danse, « le parallèle historique est plus difficile à établir ». En effet, la danse « laisse moins de traces dans les archives ». Et l’historien nous dit qu’« on la connaît par des estampes, qui montrent des hommes et des femmes qui dansent, par exemple, autour de l’arbre de la liberté, [et qu’elle] accompagne aussi les chansons[3] ».
Il se trouve que je réalise en ce moment une thèse en architecture portant sur les savoirs architecturaux des corps comme sav
