Le beau savoir est-il de droite ?
Vingt après la disparition de Pierre Bourdieu, alors que l’on vient de commémorer cet anniversaire, plusieurs des notions que celui-ci a forgées sont à nouveau débattues, notamment sa réflexion sur la distinction et le capital symbolique, et, d’une manière plus générale, celle sur les goûts sociaux.
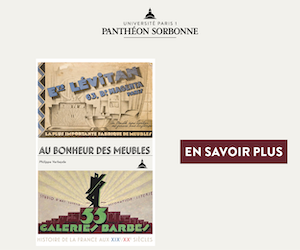
La question est ancienne, la réponse l’est tout autant : les goûts classent, et, à ce titre, le goût du beau serait socialement déterminé (on choisit une voiture, un téléphone ou un hôtel suivant son milieu). À tous les sens du terme, chacun sa classe, tout particulièrement en matière de culture (faire valoir sa lecture des classiques ou sa fréquentation de l’avant-garde en impose).
Mais qu’en est-il d’autres formes de culture ? Peut-on étendre au monde universitaire et à sa production ce regard scrutateur ? Choisir une télévision, un cours de yoga ou une lampe, c’est comme choisir un livre de philosophie analytique, d’ethnométhodologie ou d’études post-coloniales ? Y aurait-il des disciplines dont la forme correspond davantage au goût des dominants, ou, à l’inverse, à ceux des dominés ? C’est ce que Bourdieu semble dire dans son Esquisse pour une auto-analyse, lorsqu’il évoque son pas de côté et sa prise de distance avec la philosophie, cette discipline dans laquelle il avait été formé : « Le refus de la vision du monde associée à la philosophie universitaire de la philosophie avait sans doute beaucoup contribué à m’amener aux sciences sociales et surtout à une certaine manière de les pratiquer. »
L’académisme et le beau savoir
L’académisme est-il, à tout prix, l’imposition d’un goût légitime, le diktat effectif du beau ? Tout comme, selon Bourdieu, Paul Ricoeur serait un « philosophe du dimanche », l’académisme philosophique ou le « beau savoir » qui s’en réclame serait-il « de droite » ?
En opposition à l’académisme, la marque stylistique de Bourdieu est particulière, et ses mots valent autant pour leur contenu que pour leur forme. Ils sont rugueux, les néol
