La représentation blessée
« La question de la légitimation est la suivante :
est-ce que je me reconnais dans cette forme de société ? »
Paul Ricœur, Autour du politique, 1991
De la fragilité des édifices idéologiques
« Comme si c’était permis d’oublier que c’est en ma personne seule que réside la Puissance souveraine. Que c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif, sans dépendance et sans partage. Que l’ordre public, tout entier, émane de moi. […] Les droits et les intérêts de la Nation, dont on ose faire un corps séparé du Monarque, sont nécessairement unis avec les miens, et ne reposent qu’en mes mains ».
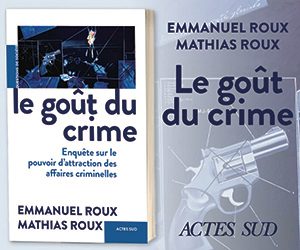
Le 28 février 1766, Louis XV vient solennellement rappeler « les maximes sacrées et immuables » qui « sont gravées dans le cœur de tout Sujet fidèle » aux Magistrats du Parlement de Paris, qui ont osé publier leurs « Remontrances » « à la face de la Nation »[1]. « C’est de moi seul que mes Cours tiennent leur existence et leur autorité », assène le roi, « Que la plénitude de cette autorité, qu’elles n’exercent qu’en mon nom, demeure toujours en moi, et que l’usage n’en peut jamais être tourné contre moi ».
En rappelant de manière aussi explicite la déférence qui est due au « gardien suprême » du royaume, le souverain expose au grand jour l’asymétrie inouïe d’un régime qui destine un seul homme à gouverner et tous les autres à obéir. Il est ainsi obligé de répéter ce qu’il ne faut pas oublier, à savoir la loyauté indéfectible qui relie « le Prince, si digne du Titre de Bien-Aimé » et son Parlement, le « Dépositaire des saines Maximes ». Si, à nouveau, « la Cour des Pairs » répétait son crime sans tenir compte de ce que « ma bonté veut bien encore leur rappeler », je devrai me résoudre, menace le roi, à « la triste nécessité d’employer tout le pouvoir que j’ai reçu de Dieu, pour préserver mes peuples des suites funestes de telles entreprises ». La menace sera mise à exécution, quelques années plus tard, lorsque le ministre Maupeou, en janvier 1771, décidera de la disso
