Communautarisme ? – Banalité de l’entre-soi et stigmatisation des minorités
Il n’existe pas de mot plus disqualifiant dans l’espace public français contemporain que celui de « communautarisme ». Ce terme flou renverrait à des formes d’entre-soi, de séparatisme et de repli de groupes partageant des pratiques et conceptions du monde social singulières, manifestant une défiance à l’égard de la mixité sociale, ethnique ou religieuse. Depuis la fin des années 1980, les musulmans incarnent cette menace spécifique pour « l’ordre républicain ». Les attentats qu’a connus la France en 2015 n’en seraient que la confirmation : le passage à l’acte de terroristes français se réclamant de l’islam sur le territoire national serait la conséquence, directe ou indirecte, du « laxisme » à l’égard du « communautarisme » rampant qui gangrènerait les banlieues [1].
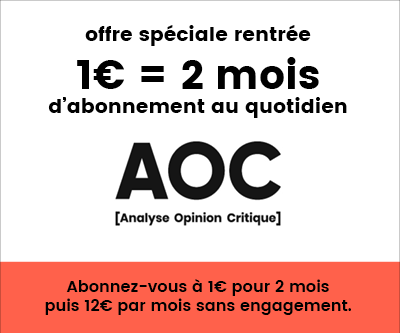
On pourrait faire le choix de laisser le terme de « communautarisme » de côté, de le marginaliser, tant ce à quoi il renvoie est mouvant, toute tentative de conceptualisation contribuant à légitimer une notion d’ordre plus profane et idéologique que scientifique [2]. Cependant, du fait de l’explosion de son usage ces dernières années il mérite d’être à la fois déconstruit et analysé. Le communautarisme renvoie à deux univers de discours distincts mais liés. Il fait à la fois référence à des formes de vie et à des revendications issues de certains groupes sociaux, ethniques ou religieux. Les adeptes de l’usage de cette notion considèrent que certains groupes souhaiteraient vivre « entre eux » plutôt que mélangés, les musulmans étant particulièrement pointés du doigt à cet égard, désirant vivre ensemble dans des « enclaves ethniques » [3].
Les travaux sociologiques – tels ceux de Patrick Simon, Bruno Cousin et Jules Naudet dans l’ouvrage que nous publions à la fin du mois – indiquent pourtant toute autre chose. Si certains quartiers concentrent davantage de minorités ethno-raciales que d’autres [4], cela tient d’abord à des politiques de peuplement ethnicisées [5] plutôt qu’à des choix résidentiels spéc
