Quand Goethe n’avait plus sa place en Allemagne – sur Philisterburg de Jacques Decour
Dans Philisterburg, Jacques Decour, assassiné par les nazis en 1942, amoureux de la culture germanique, fait le récit sous forme de journal de son séjour en tant que professeur d’échange durant l’année scolaire 1930-31 à Magdeburg, cité industrielle prussienne.
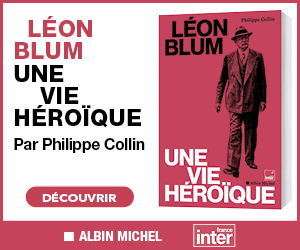
De Jacques Decour, de son vrai nom Daniel Decourdemanche, on a surtout retenu qu’il a été assassiné par les nazis. C’était le 30 mai 1942, au mont Valérien, il avait 32 ans. Communiste, il avait été livré aux Allemands par la police française en raison de son activité dans la Résistance. Parmi ses hauts faits d’armes clandestins et littéraires, il est à l’origine, en relation avec Jean Paulhan, des Lettres françaises, en 1942, dont il ne vit paraître le premier numéro à cause de son arrestation.
On connaît moins ses livres. Sans doute parce qu’ils sont peu nombreux : trois au total. Deux romans, Le Sage et le Caporal (1930) et Les Pères (1936), et le livre que les éditions Allia rééditent aujourd’hui, le récit d’un séjour en Allemagne écrit sous la forme d’un journal, ayant pour titre Philisterburg, et publié initialement en 1932.
Philisterburg est un nom de ville imaginaire. Au vrai, Jacques Decour a passé un an comme « professeur d’échange » à Magdeburg, ville industrielle de 300 000 habitants, située dans l’Allemagne orientale, en Prusse. « La ville des philistins » : le titre choisi n’est pas à l’honneur des habitants. Injuste ? Le jeune homme aura tout le loisir de s’en rendre compte : les « Philisterbourgeois » sont peu ouverts aux arts et à la littérature et fermés d’esprit. Alors qu’il parcourt les rues de la cité, voici ce qu’il relève, non sans ironie : « La seconde partie de la grande rue, c’est le centre de la ville. On y voit de beaux magasins de jouets, de charcuterie, d’objets d’art. Les jouets et les charcuteries sont, sans conteste, des chefs-d’œuvre d’invention, de variété et de goût. Les objets d’art n’ont aucune de ces qualités. »
Il faut dire aussi que l’époque voit son horizon
