De l’inégale géonumérisation du Monde
Horror vacui : une expression latine qui signifie littéralement terreur du vide. Dans les Arts visuels, ce concept définit l’acte de remplir complètement toute la surface d’une œuvre avec une multitude de détails. L’horror vacui s’apparente, par exemple, à certains styles de graphisme postmoderne comme les travaux du designer David Ray Carson ou les dessins de comics de Mark Beyer.
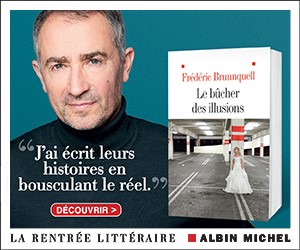
Alors qu’en physique, l’horror vacui reflète l’idée d’Aristote selon laquelle « la nature a horreur du vide », en géographie, longtemps, les géographes-explorateurs ont été fascinés par les blancs des cartes qui étaient sources de motivation pour aller découvrir des terres lointaines. Ils ont pu servir aussi le pouvoir politique en étant source de légitimation de la conquête coloniale. Longtemps aussi, les blancs des cartes ont été assumés par une cartographie dite « moderne » qui s’est servie du vide comme d’un support d’affirmation de ce qui était plein.
À l’ère du big data, la cartographie semble progressivement basculée dans une forme d’horror vacui. Face à un monde numérique qui déborde de données, une phobie des blancs de la carte s’empare des cartographes qui s’appuient sur les progrès technologiques pour les invisibiliser en quelques clics.
Accélération de la géonumérisation du Monde
Pourtant, si les transformations technologiques de ces dernières années conduisent à une profusion de données géographiques qui circulent en ligne, la bulle informationnelle qui nous entoure est loin d’être homogène d’un endroit à l’autre de la planète. L’autorité de l’État en matière de cartographie est ainsi progressivement remise en cause par de nouveaux faiseurs de cartes : des professionnels du secteur – géographes, cartographes, data analyst, data scientist… – plus nombreux et aux profils plus diversifiés, mais aussi de nouveaux acteurs : militants, journalistes, hackers, artistes, etc. Désormais, sur le web, les cartes sont partout.
Le Covid-19 a fourni un bon exemple de cette boulimi
