Wikipédia, un modèle de réseau social numérique modéré ?
En avril 2023, le nouveau règlement européen sur les services numériques (DSA) visant à une responsabilisation des plateformes numériques a été publié. Son objectif est notamment de lutter contre la diffusion de contenus en ligne dits illicites ou préjudiciables, tels que les attaques racistes ou la désinformation.
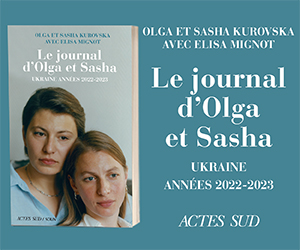
Dix-sept très grandes plateformes sont déjà visées, dont Facebook, YouTube, Twitter ou Wikipédia. L’association Wikimédia France a rapidement exprimé de vives inquiétudes quant au fait d’être placée sous le joug de cette législation[1].
Faire entrer Wikipédia dans le champ des très grandes plateformes, et plus encore peut-être dans celui des réseaux sociaux numériques, invite nécessairement à interroger la modération et la régulation des formes de parole politique qui y émergent. Ces dernières années, on a pu observer en effet un phénomène de montée en puissance de stratégies militantes et partisanes pour propager du contenu idéologique au sein de Wikipédia[2], et l’extrême droite paraît particulièrement active. Quelle imputation de responsabilité quand des contributeurs, parfois extrêmement organisés, diffusent de la désinformation ou des contenus illicites voire haineux sur l’encyclopédie en ligne ?
Wikipédia, encyclopédie en ligne lancée au début des années 2000, participe à relier des individus entre eux et à les faire interagir, afin de produire des connaissances encyclopédiques, notamment sur et dans le champ politique, pour y donner accès au plus grand nombre, hors des espaces traditionnels de la production de savoirs[3].
Ainsi, si Wikipédia ne permet pas l’affichage et l’articulation d’une liste d’« amis »[4], il permet l’implication d’utilisateurs dans une communauté en ligne qui relève d’intérêts communs[5], dont la discussion est sans cesse favorisée. Il n’y a pas de likes ou émojis sur Wikipédia mais les réactions sont captées par les jeux de modifications, commentaires, suppressions et ajouts constants auxquels se livrent les contri
