Cent ans plus tard, les Kurdes au bord de la survie
Voilà : le 29 octobre, c’est le centenaire de la fondation de la République de Turquie. Des commémorations, des conférences, des célébrations, des émissions de radio et de télévision, des films documentaires, des podcasts, des numéros spéciaux de magazines et des livres ont déjà vu le jour ou sont en cours de préparation dans de nombreux domaines.
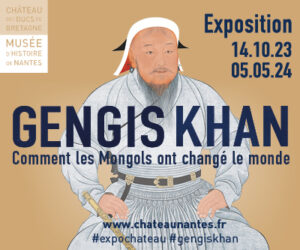
On peut je crois diviser les discussions autour de cet anniversaire en deux grandes catégories. D’un côté, l’approche apologétique, celle du « roman national », qui considère la République (toujours avec l’attribut « turque ») comme la plus grande, la plus progressiste et la plus triomphante réalisation de la nation turque. De l’autre un ensemble d’approches et de récits que l’on peut qualifier de « subalternes », « minoritaires » et critiques. Ceux-ci considèrent la République de Turquie avant tout comme un régime oppressif, au profit des Turcs, des hommes et des musulmans sunnites, au détriment des autres identités (ethniques, religieuses, sexuelles).
Selon cette perspective, la République turque s’intègre dans la continuité d’un tropisme pluriséculaire de domination et a produit un nombre incalculable de victimes, et elle doit être « démocratisée » à tous les niveaux, voire complètement réformée et reconstruite à partir de zéro[1]. Alors que le premier groupe célèbre et exalte tout ce qui a été accompli au cours du siècle « grâce » à la République, le second s’inscrit dans un régime discursif que j’ai ailleurs qualifié de « victimo-mémoriel », au sens de Johann Michel[2], insistant sur les drames humains, politiques et ethniques survenus en son nom et « à cause » d’elle.
L’approche apologétique se divise elle-même en deux orientations mémorielles. L’une souligne la rupture inaugurale constituée par la création de la République, expression de la turcité moderne et laïque et fondée sur la citoyenneté, en rupture avec l’Empire et l’autocratie ottomans. L’autre, incarnée par les partisans d’Erdogan, de l’AKP et de
