Instituer l’accès aux données des plateformes numériques
La requête des chercheurs ou des services publics d’accès aux données des plateformes numériques est tout à fait légitime tant elle correspond à un impératif de la nouvelle ère de quantification contemporaine : les traces de propagations accessibles après les sondages d’opinion et les recensements[1].
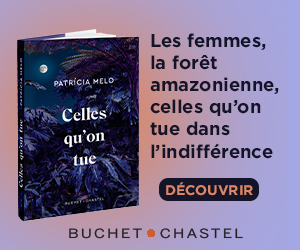
Cependant, il serait vain d’attendre une coopération de la part de plateformes habituées pendant 15 ans à la prédation des données personnelles et au contournement de toutes leurs responsabilités. De ce fait, les demandes des chercheurs risquent de se réduire à quémander un accès provisoire et opaque comme un privilège qui peut à tout moment être révoqué comme on l’a vu avec les partenariats scientifiques noués par Facebook via Social Science One (NYU en 2021).
L’enjeu est pourtant essentiel : il faut bâtir les conventions socio-économiques et techniques pour rendre opérationnelle et socialement utile la nouvelle ère de quantification qui est la nôtre, faite de big data, de machine learning et d’IA et entièrement contrôlée par les plateformes du capitalisme financier numérique, les GAFAM. Il ne s’agit pas d’un pacte avec le diable, pas plus que ce fut le cas entre sciences sociales et dispositifs statistiques des États au début du XXe ou entre sciences sociales et sondages d’opinion gouvernés par les médias et les marques à partir des années 30. Dans les deux cas, les statistiques, comme le montre si bien Alain Desrosières, ont servi à prouver ET à gouverner, au prix d’alliances, de passerelles, de conventions réécrites et rendues à la fois efficaces et valides.
La tâche actuelle est identique et il serait totalement naïf de passer sous silence le mécanisme de financement publicitaire qui gouverne toutes ces plateformes et qui justifie l’usage massif des traces. C’est plutôt sur la base de ce modèle économique qu’il convient de parvenir à intéresser les différentes parties prenantes, en premier lieu les marques, à une institution autonome et crédible de mesur
