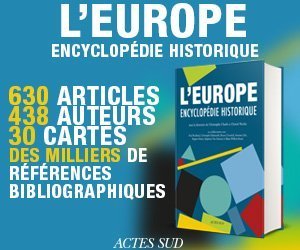Rap et médias, une longue histoire de défiance
Aujourd’hui, le rap est partout : à la radio bien sûr, mais également dans les génériques d’émissions télé, les jeux vidéo, dans les reportages et les films, sur les réseaux sociaux et plateformes web, dans les cités et les beaux quartiers, dans les défilés haute-couture, sur le bitume, dans les stades, les librairies, les théâtres, les musées, dans les slogans des manifestations, le langage, la gestuelle… et même dans les colloques scientifiques ! Pourtant, le traitement médiatique du rap pose encore question. L’« affaire Booba/Kaaris » apparaît, en ce sens, symptomatique de la manière dont on « parle » du rap : faits divers, illégalité, marginalité et rejet de l’ordre établi. Le fait que les deux protagonistes, parmi d’autres, soient des artistes et entrepreneurs à succès, positionnés au cœur d’un écosystème mêlant marques de vêtements, de spiritueux, médias spécialisés et labels de musique est généralement passé sous silence. Pour le comprendre, il faut considérer le traitement médiatique du rap sur le temps long, en analyser les évolutions, les ruptures et ce qu’elles nous disent des liens complexes qu’entretiennent le monde médiatique et celui du rap.
Les médias, notamment grand public, ont commencé par se désintéresser du rap : les grandes radios et publicitaires craignaient principalement de voir leur image associée à ce genre et à ses clichés, notamment sur la banlieue, le rejet de la société et de l’ordre en place. Quelques émissions télévisuelles ont toutefois vu le jour, et d’abord H.I.P.H.O.P., présentée par Sidney alias Patrick Duteil dès 1984 sur TF1, même si elle était davantage orientée danse que rap. On peut également citer, un peu plus tard, RapLine, animée par Olivier Cachin, et stoppée au bout de trois ans. Cette émission, diffusée après minuit et qui oscillait entre 0,5 et 0,8 point d’audience a ensuite été remplacée par Fax’O, une émission de musique généraliste à 18h toujours animée par Olivier Cachin, mais qui abordait le rap parm