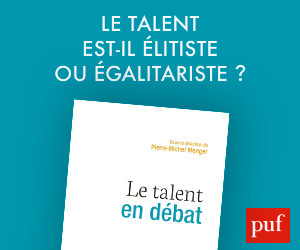High Life de Claire Denis ou la métaphysique narrative
Dans le vaisseau spatial n°7, en route vers un trou noir à mille miles-lumière du système solaire, ne règne pas l’apesanteur. Une justification scientifique sera même fournie pour ce phénomène. L’apesanteur est ailleurs.
Elle est dans la fascinante, émouvante, troublante déliaison des gravités narratives qui organisent, et le plus souvent corsètent pratiquement tout le cinéma. Tout le cinéma « de fiction » aussi bien que documentaire, tout le cinéma qui raconte une histoire. Pourtant High Life raconte une histoire, une sacrée histoire. Mais pas comme ça.
Sur terre, ils étaient des criminels, des déchets de la société. Dans l’espace, ils sont des cobayes, livrés à une double expérimentation, sur les confins de l’univers et les phénomènes limites de gravité, et sur les possibilités de se reproduire dans des conditions extrêmes. La docteure Dibbs recueille semence et ovules, bricole avec ses éprouvettes. La violence et le désir font vibrer les corridors de cette arche spatiale aux formes d’armoire normande.
On voit la parabole, le trou noir est, aussi, ce vers quoi se dirige tout être vivant. Et c’est bien l’humaine condition travaillée par les pulsions de mort et de vie qu’invoque ce film incantatoire, traversé par des cris de haine, des râles de jouissance et des babils de bébé, au milieu du vide intersidéral de notre commune solitude. Mais pas seulement. Mais pas si simple. Film après film, Claire Denis développe une idée du cinéma se déployant selon des logiques inédites, où ni la psychologie, ni la morale, ni le romanesque académique n’imposent leur carcan. Qu’elle s’inspire d’un fait divers (J’ai pas sommeil), d’une situation biographique (Chocolat), de films de genre (la guerre pour Beau travail, l’horreur pour Trouble Every Day), d’un roman (Vendredi soir), d’un classique du cinéma (35 Rhums), d’une situation géopolitique (White Material), d’un texte philosophique (L’Intrus), toujours elle défait et réagence les éléments de récit – ce qu’on a l’hab