Orbán force notre université à l’exil
28 novembre dernier, 17h30, dans l’auditorium du nouvel immeuble de la Central European University, 15 Nador Street, situé au cœur de Pest, le politiste de Harvard Yascha Mounk s’apprête à dialoguer avec le recteur Michael Ignatieff sur le thème de la situation du libéralisme politique dans le monde aujourd’hui. On mesure le caractère ironique de la question dans l’antre de la « démocratie illibérale » dont le Premier ministre hongrois a fait son cheval de bataille. Depuis vingt mois, M. Orbán a fait de la lutte contre l’Université d’Europe centrale l’un de ses objectifs principaux.
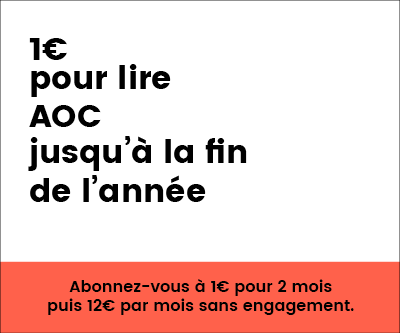
Une Lex CEU (en fait un amendement à la loi sur l’éducation) a été votée pour contraindre toutes les universités étrangères présentes sur le sol hongrois à avoir des activités dans leur pays d’origine. La loi visait explicitement le petit établissement privé créé en 1991 à l’initiative du mécène états-unien d’origine hongroise George Soros, lui-même devenu le principal bouc-émissaire du régime autoritaire hongrois : les deux dernières années ont vu des campagnes d’affichage qui ne dissimulaient pas leur caractère antisémite : le milliardaire juif était identifié avec le « péril migratoire musulman », inexistant en Hongrie mais objet de constantes et malhonnêtes propagandes, alliage unique entre antisémitisme et islamophobie. Encore plus absurde, la consultation Stop Bruxelles, dirigée contre l’Union européenne, pourtant généreuse en subventions pour le régime, ne suscitait de la part de l’institution bruxelloise aucune réaction, comme si tout était permis à M. Orbán, « my little dictator » comme l’a appelé un jour, pouffant de rire, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne.
Au cours des derniers mois, vous auriez pu croiser ainsi Pierre Rosanvallon, Michelle Lamont ou, plus récemment, le juriste Olivier Beaud.
En cette fin d’après-midi froide et humide, le public se pressait pour entendre parler d’un thème qui n’aurait pu être développé en aucun autre lieu de la capi
