Fabriques de peuples
Le peuple fait retour dans la politique contemporaine. Du moins le signifiant « peuple ». Sous le signifiant, un spectre sans doute. Les mouvements de contestation de la décennie 2010, d’Athènes à New-York, en passant par Tunis, Le Caire, la Syrie, Hong Kong ou Santiago et Paris, se sont donnés comme intervention du peuple contre les gouvernants, voire contre les élites, jusqu’à se reconnaître sous la bannière nationale. Ce, en déployant les ambiguïtés inhérentes à de la notion.
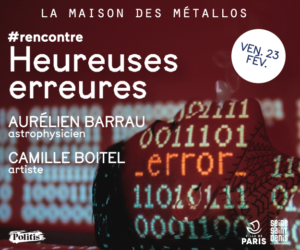
Ethnos, démos, plethos, ochlos, laos, populus, plebs, turba, multitudo ? Nation, Peuple souverain, plèbe, multitude, foule, communauté autonome ? Classes populaires aussi, pour le dire avec des mots de la sociologie politique[1], conjuguant le vocabulaire du peuple et celui des classes, occulté en « classes moyennes » par le discours économiciste dominant. Démocratie, république, pouvoir du peuple, populisme, souveraineté populaire ? Selon la scène, celle de la nation, du parlement, ou de la rue, selon la scénographie médiatique aussi, ce sera l’un ou l’autre, l’un et l’autre mêlés. « Peuple » est un concept impur.
Un constat : les luttes politiques ne sont plus conduites dans le vocabulaire des classes. Celles-ci n’ont pour autant, pas plus que la lutte des classes, disparu. Ce changement de vocabulaire signe une évolution que la sociologie politique enregistre : « Plus que la fin de la classe ouvrière, nous assistons aujourd’hui à la fin de l’hégémonie que la classe ouvrière a su bâtir sur le populaire[2]. » Comme à chaque crise depuis le XVIIIe siècle, l’hégémonie du signifiant « peuple » pour nommer le sujet politique, sans lever ses ambiguïtés, bien au contraire, est le symptôme d’un changement profond dans la manière de concevoir et de conduire le conflit politique.
Sans doute, au lendemain de l’effondrement du communisme bureaucratique, certains ont-ils cru à son évaporation, à l’avènement d’une société apaisée, réconciliée avec elle-même. C’était oublier l’essence même de l
