Au Sahel, un décolonialisme militaire
En publiant un article très critique sur la politique catastrophique d’Emmanuel Macron au Sahel (en particulier à propos de la punition collective infligée aux populations locales), je n’avais évidemment pas pour objectif de conforter la stratégie des régimes militaires au pouvoir et d’exonérer leurs propres responsabilités dans la rupture avec la France. En général il faut être deux pour se fâcher de façon aussi radicale, et toute escalade implique les deux parties.
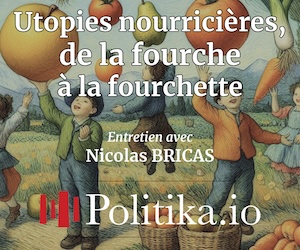
Une analyse de la façon dont les officiers qui pilotent les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger instrumentalisent et amplifient les ressentiments populaires à l’égard des anciens colonisateurs (leur « francophobie ») me semble donc nécessaire et complémentaire, d’autant plus que le fait de rendre la France (et à travers elle l’Occident) responsable de toutes les déceptions des indépendances, de tous les échecs des démocraties, de toutes les impasses du développement, rejoint de façon intéressante le pôle le plus radical d’un courant intellectuel devenu à la mode tant en Afrique que dans le monde, sous le label de « décolonialité » ou de « décolonialisme ». Je vais donc faire un détour préalable par cette école de pensée avant d’examiner sa connexion avec les discours des officiers au pouvoir et les acclamations de leurs supporters.
Le paradigme décolonial et ses variantes
Le paradigme décolonial a pris naissance en Amérique latine, chez des auteurs relevant plutôt de disciplines littéraires et herméneutiques. La colonisation à laquelle leur récit alternatif se réfère est celle de l’Amérique à partir de l’arrivée de Christophe Colomb à la fin du XVème siècle, marquée par la soumission et le massacre des peuples dits « indigènes ». Mais cette colonisation espagnole ou portugaise, qui fut aussi une colonisation de peuplement, a pris fin depuis bien longtemps, autrement dit les souvenirs politiques directs de sa domination, de son arbitraire, et de sa violence se sont largement esto
