D’une absence l’autre : penser la condition migrante avec Abdelmalek Sayad
La dernière loi sur l’immigration de décembre 2023 n’a fait qu’ajouter une pierre à l’édifice législatif et idéologique commencé dans les années 1970, visant à rendre invivable la vie des étrangers indésirables sur le sol français puis européen. Les enjeux économiques autant qu’humains sont de plus en plus soumis aux idéologies sécuritaires et identitaires. Celles-ci dominent tout le débat public sur la question migratoire aujourd’hui, et rendent impossible la transmission apaisée des connaissances et des questions de fond sur le sujet.
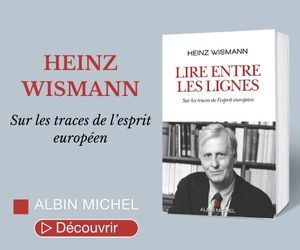
En organisant ces dernières semaines des manifestations et rassemblements qui ont fait converger la lutte contre la loi immigration en France et le soutien à la population palestinienne à Gaza, les mouvements de protestations ont fait plus que suivre l’actualité. Ils ont montré la continuité et la « convergence des luttes » entre deux conditions marquées par les politiques de tri et d’effacement, au risque de la disparition[1].
Relire « La double absence »
Un an après le décès d’Abdelmalek Sayad (1933-1998), Pierre Bourdieu publiait au Seuil, dans la collection Liber qu’il dirigeait alors, un livre regroupant plusieurs articles écrits entre 1975 et 1996 par celui qui fut son assistant (en Algérie) puis son collègue et ami : La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré[2]. Dans ce recueil, Sayad met en évidence le lien structurel entre émigration et immigration, à la fois économique et culturel. Son projet est de combattre « l’ethnocentrisme » de la définition de l’immigré et la méconnaissance (intellectuelle autant que politique) de l’émigré. Il faut toujours penser l’un avec l’autre, pour comprendre les espoirs et les désillusions des émi-immigrés. Or, cette même année 1999 inaugure de nouvelles politiques, avec par exemple les premières tractations de quelques États européens pour organiser ce qui s’appellera plus tard et se généralisera comme la politique « d’externalisation » des frontières
