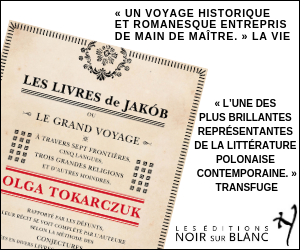Fake news : l’arbre qui cache la forêt
On parle beaucoup de fake news ou de fausses informations depuis la campagne présidentielle de 2017. Après l’irruption de ce terme dans notre quotidien et nos médias suite à la victoire de Donald Trump, les fake news ont fait figure de nouvelle menace pour nos démocraties et ont été l’objet de nombreuses études scientifiques. L’une d’entre elles, parue récemment dans la prestigieuse revue Science, démontrait à partir d’une analyse des contenus américains de Twitter, que les fausses informations politiques se propagent plus vite et touchent en moyenne plus de personnes au sein de l’espace public numérique que tout autre type d’information.
Ce résultat peut paraître alarmant et justifier l’engouement des médias et de l’exécutif pour ce phénomène. Les fausses informations sont cependant l’arbre qui cache la forêt.
Pour bien comprendre les enjeux, précisons qu’une fausse information n’est ni une opinion, ni un avis, mais une information présentée comme un fait avéré alors qu’il est faux et peut donc être réfuté. Par exemple « Mélenchon porte une Rolex ». Dans un récent article paru dans la revue PLoS ONE, nous avons étudié la diffusion des fausses informations sur Twitter pendant la campagne présidentielle française de 2017 en répondant en premier lieu à la question plus générale de la structure de cet espace public numérique.
En suivant sur Twitter plusieurs milliers de personnalités politiques et les échanges dans lesquels elles étaient impliquées ou mentionnées, nous avons analysé de juillet 2016 à mai 2017 plus de 60 millions de tweets politiques produits par plus de 2,4 millions d’internautes dans le cadre du projet Politoscope mené au CNRS par l’Institut des systèmes complexes de Paris IdF. L’article propose une définition algorithmique des communautés politiques numériques à partir de l’analyse des échanges sur Twitter : les sous-ensembles de comptes qui relaient entre eux, de façon récurrente, dense et sans modification, des contenus (retweets). Cett