Sous le storytelling, la spirale du discrédit
En 2019, le mot « storytelling » entrera dans le Petit Robert. Une consécration pour ce mot qui a fait irruption dans le débat public en novembre 2007 à l’occasion de la parution à La Découverte de mon livre : Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits. À l’époque, le mot était si peu familier que les représentants de la maison d’édition avaient émis un avis négatif sur le titre du livre qui leur semblait incompréhensible et donc invendable. « Storytelling, c’est du chinois pour les libraires », m’avait dit l’un d’eux. L’éditeur François Gèze avait tenu bon mais avait prévu une mise en place modeste pour tenir compte de ces augures pas très encourageants. La première édition fut épuisée en quelques jours et le livre fut sans cesse réimprimé jusqu’à sa parution en édition de poche un an plus tard. Traduit en une quinzaine de langues, vendu à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires toutes éditions confondues, le livre est devenu à la grande surprise de son éditeur et de son auteur un phénomène d’édition.
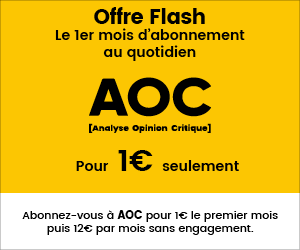
Tant d’efforts sont accomplis par les agences de communication pour imposer dans le débat public et sur les réseaux sociaux, une marque, un concept ou un simple hashtag, qu’il semblait impossible qu’un mot non répertorié, une sorte de clandestin médiatique, de concept « sans papiers » puisse faire son chemin aussi facilement jusqu’à obtenir une sorte de naturalisation linguistique en entrant dans le Petit Robert, un mot banal assez plastique pour s’adapter à des contextes très différents et doté d’une sorte d’« aura » qui le rend compréhensible et disponible pour tous.
Inconnu il y a dix ans cet anglicisme qui signifie l’art du récit, pour lequel on ne trouvait sur le web en français que deux occurrences, est devenu en une décennie la clef des discours politiques, un cliché du décryptage médiatique, le nouveau credo du marketing, une boussole pour naviguer sur les réseaux sociaux, une injonction de la mode… Longtemps considére
