Empathie, bons sentiments et mauvaise politique
Plus de trois semaines après le démarrage de la crise des Gilets Jaunes, tandis que cette dernière ne cessait de s’amplifier, nombreux furent ceux qui lancèrent des appels pressants au Président de la République, l’enjoignant de prendre la parole. Ecoutons-les et nous entendrons alors une curieuse musique dont l’un des refrains essentiels est construit autour de la notion d’« empathie ».
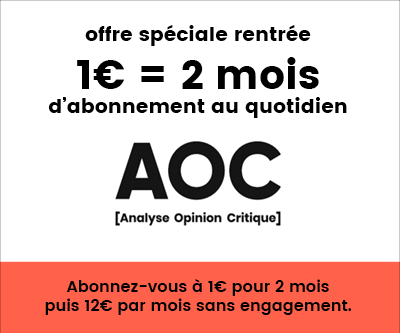
Les Français attendent du président Macron un « discours d’empathie » face à leurs difficultés, estimait ainsi le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger. Emmanuel Macron doit « tenir un discours d’autorité, mais aussi de compréhension, d’empathie », affirmait Alain Juppé. « Nous avons réclamé ce dialogue et cette empathie à l’égard des élus locaux, qui peut largement contribuer à l’unité nationale », expliquait un autre ténor de la droite. Bien des journalistes reprirent également en chœur ce refrain de l’empathie. Avant son discours, pour mieux le saluer après ! On interrogea des citoyens qui à leur tour reprirent la ritournelle : pour Sabine par exemple, « il a fait un très bon discours. Il y avait de l’empathie. ».
Simple coïncidence ? Voire phénomène de mode sémantique dont le paysage politique et médiatique est coutumier et qui ne mérite pas que l’on s’y arrête ? Pourtant qui peut croire que les mots seraient à ne pas prendre au sérieux ? Surtout lorsque l’on parle de politique. Essayons donc de saisir quelles pourraient être les raisons de ce soudain engouement pour l’empathie de la part d’un certain nombre d’acteurs et de commentateurs politiques – cette « faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il ressent » (Dictionnaire Larousse). Nous verrons que l’on peut en identifier plusieurs, de natures assez différentes, mais surtout que l’empathie du président de la République, n’est ni une condition suffisante, ni une condition nécessaire de la résolution de la crise que traverse notre pays.
