La guerre nucléaire qui vient
Les 6 et 9 août 1945, deux bombes atomiques réduisaient en cendres radioactives les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki. Depuis, les veilleurs, c’est-à-dire ceux qui ne se sont pas assoupis dans le confort d’une vie bourgeoise et non réfléchie, se demandent : quand, où et comment ce sera la prochaine fois ? Ils savent au moins que le nombre de morts ne sera pas alors une centaine de milliers, mais des centaines de millions. Jusqu’il y a deux ans à peu près, l’un des meilleurs observateurs du domaine, après avoir été l’un de ses principaux acteurs, William Perry, l’ex-secrétaire à la Défense du président Clinton, répondait : ce sera un acte terroriste. Aujourd’hui, il conjecture comme beaucoup : ce sera le résultat de l’affrontement entre les deux seules superpuissances nucléaires, les États-Unis d’Amérique et la Russie, qui à elles-deux détiennent plus de 90% des armements de la planète. Nous sommes revenus aux pires moments de la Guerre froide.
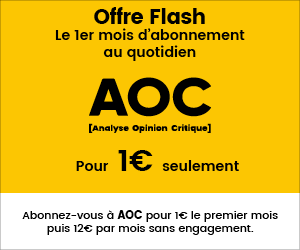
Les plus âgés d’entre nous se souviennent de la crise des euromissiles qui fit trembler de peur l’Europe entre 1976 et 1987. En mars 1976, l’Union Soviétique déploie dans sa partie européenne des missiles SS20 d’une portée d’environ 5.000 km, capables donc d’atteindre l’Europe occidentale, mais aussi la Chine et le Japon. Devant cette agression, le président américain Jimmy Carter juge dans un premier temps que ses armes nucléaires stratégiques à longue portée suffisent pour dissuader une éventuelle attaque surprise sur l’Europe. Mais le chancelier allemand Helmut Schmidt fait pression pour que l’Amérique intervienne. En décembre 1979, un sommet de l’OTAN prend une double décision : faire pression sur l’Union Soviétique pour qu’elle retire ses SS20 et, si ces négociations échouent, installer en Allemagne dans un délai de quatre ans des missiles américains de portée moyenne, les Pershing II.
Suit une période confuse où des phrases restées célèbres sont prononcées. Les pacifistes allemands, soutenus par le parti com
