Doublures du monde – sur Jour de ressac de Maylis de Kerangal
On a beau chercher, il y a peu de récits de Maylis de Kerangal à la première personne : son écriture romanesque rassemble davantage un chœur de personnages noués à un lieu, un pont, un promontoire, ou à un événement comme une opération du cœur. Même si la fiction se mêle à la figure de la narratrice, quelque chose d’intime résonne ou se questionne dans cette voix portée par le je, et d’autant plus qu’il s’agit pour elle de revenir sur les lieux, de déambuler dans un paysage familier, celui du Havre, où l’autrice a passé son enfance.
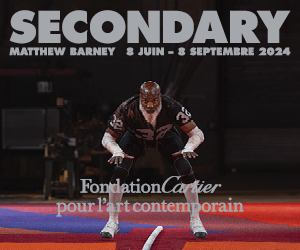
Si chacun porte en lui un paysage premier, nul doute que Le Havre a donné sa couleur et son rythme à l’imaginaire de Maylis de Kerangal. De roman en roman, elle ne cesse d’écrire l’aimantation des paysages, la force d’attraction des lieux, mais c’est comme s’il fallait attendre Jour de ressac pour qu’elle creuse cette épaisseur de mémoire qu’irrigue la ville portuaire. Le Havre est bien le cœur battant du livre, son pôle magnétique, comme on le fait remarquer à la narratrice : « Mais là, Le Havre, ça te fait vriller ; c’est Le Havre ton problème. »
Si la narratrice fait retour dans la ville de l’enfance, c’est à la suite d’un coup de téléphone d’un officier de police judiciaire : on vient de retrouver un corps sur la digue, avec son numéro griffonné sur un ticket de cinéma, et il faut qu’elle vienne pour essayer de l’identifier. Pour autant, même si Maylis de Kerangal s’ingénie à solliciter certains éléments du polar, l’enquête tourne court, ou plutôt elle bifurque. Car en revenant au Havre, c’est à la poursuite de ses souvenirs, de ses expériences amoureuses, de sa rencontre avec le cinéma : le ressac du titre, c’est celui de la mémoire et du passé qui ressurgit. Si le roman prend de fausses allures de roman policier, dépliant « [u]ne sorte d’enquête », c’est une enquête dans les replis et les reflux d’une mémoire incarnée : « Tout se passait comme si la lubie de l’enquête s’était emparée de moi. »
Le livre est porté par une v
