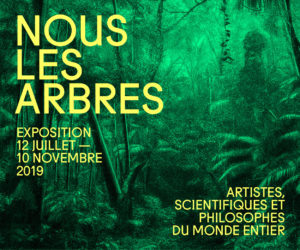La machine à voir de Jules Spinatsch – à propos d’un statut du documentaire en art
Les visual studies situent volontiers un documentary turn dans le courant des années 90 dans le champ des arts, et des arts visuels en particulier. En tenant à bonne distance la propension historiciste qui accompagne souvent ces modes de pensées académiques, il n’en est pas moins fécond d’interroger cette hypothèse d’un tournant documentaire. De s’en saisir comme d’un symptôme situé et actuel pour toutes les écritures photographiques et filmiques, autant que comme une tendance longue affectant le champ de l’art.
Un tel axe d’analyse rapporté à la pratique de la photographie comme langage de l’art est productif, porté par une longue production d’écrits comme, pour aller très vite, ceux de Susan Sontag, ceux d’Olivier Lugon sur le style documentaire, par les textes et réflexions d’artistes comme Alan Sekula, par de nombreuses expositions et programmes, tels les documenta 10 et 11, en 1997 et 2002.
Le programme d’exposition et de discussions fédéré sous le titre The need to document, dont les actes sont publiés en 2005, souligne combien le contexte du post-capitalisme tardif et les transformations dans le champ politique obligent l’art à reconsidérer le rapport au monde, à réarmer les formes de saisie et d’attention au champ social et aux constructions politiques.
À tout le moins, la perspective ainsi tracée ouvre un territoire de questionnement productif touchant aux modes d’implication de l’artiste dans l’acte photographique, sollicitant la différenciation parmi les régimes de l’image et obligeant à repenser à nouveaux frais le mode d’efficience politique d’images portées par cette sorte d’ambition. Une ambition porteuse d’une possible re-définition de la relation de subjectivité que le photographe met en œuvre par ses décisions de prise de vue.
Le virage documentaire est le nom, avant tout, d’une mise en cause permanente et des plus ouvertes des assignations propres à l’acte photographique, aux gestes et décisions de l’auteur d’image. Ses implications cog