L’art critique de Jean Starobinski
« Artiste et interprète. » C’est par ces mots que Gérard Macé désigne Jean Starobinski en annexe d’un important livre d’entretiens dont le titre, emprunté à Montaigne, résume la démarche de l’artiste en question : La parole est à moitié à celuy qui parle…
Par ces mots, puis par cette citation, la nature et la qualité de l’œuvre sont soulignées. Certes, ce n’est ni un mensonge ni un rabaissement de qualifier Starobinski de critique, ou, plus largement d’essayiste. Mais il manque alors quelque chose.
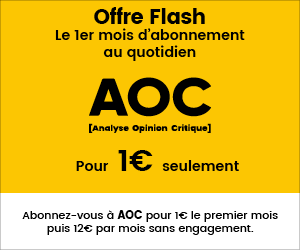
Une distance s’établit, que l’on voudrait dire scientifique. Cela au détriment d’un élément essentiel, difficile à cerner et à qualifier mais qui innerve la méthode et toute l’œuvre de Starobinski. Le même Gérard Macé, dans Des livres mouillés par la mer, Pensées simples III, met en parallèle le refus, ou le retrait, au profit de l’activité analytique, de la création littéraire chez Lévi-Strauss et chez Starobinski : repli déçu et attristé pour le premier, serein et déterminé pour le second, « trop porté à l’autocritique », et qui « se retire sur la pointe des pieds, sans amertume ni jalousie ». À la fin de la préface de son grand Montaigne en mouvement, Starobinski cite ces mots de l’essayiste (difficile, là, d’éviter ce terme…) : « Il y a plus à faire à interpréter les interprétations qu’à interpréter les choses, et plus de livres sur les livres que sur autre subject : nous ne faisons que nous entregloser. Tout fourmille de commentaires… »
Je choisirai deux thèmes, qui courent dans toute l’œuvre, à des niveaux divers, à la fois et solidairement comme objets d’étude et motifs d’une profonde interrogation, d’un retour réflexif sur soi. Étant entendu que ce retour ne se situe pas, comme c’est si souvent le cas, sur le terrain de l’introspection narcissique. Afin d’esquisser ce portrait, un peu à l’image de celui que Starobinski fit de « l’artiste en saltimbanque » et d’éviter un hommage en forme de nécrologie académique, je mettrai en avant deux thèmes que l’on n’a pas f
