L’inceste comme atteinte au langage (1/2)
L’ouvrage collectif Dire, entendre, juger l’inceste, du Moyen Age à aujourd’hui, sous la direction d’Anne-Emmanuelle Demartini, Julie Doyon et Léonore Le Caisne ouvre un nouveau champ de recherches interdisciplinaires sur l’inceste, en affrontant avec les méthodes de l’histoire, du droit, de la sociologie, de l’anthropologie et de la psychologie, trois grandes questions.
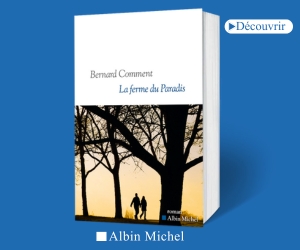
Quelles sont, d’hier à aujourd’hui, les normes sociales et juridiques prohibant l’inceste, dans quel contexte socioculturel prennent-elles leur sens, et quelles évolutions peut-on constater dans le temps long de l’histoire occidentale ? Comment et par qui les violences incestueuses sont-elles commises au sein des familles, en particulier sur des enfants, pourquoi et avec quels effets sont-elles tues ou à l’inverse dénoncées par les victimes et leur entourage, selon quelles procédures sont-elles punies ou non par la justice ? Et enfin que nous apprend la clinique « psy » au sens large – psychologie, psychiatrie, psychanalyse – des effets dévastateurs de ces violences incestueuses sur les jeunes victimes, filles et garçons, et sur les voies d’une possible résilience ?
À la lecture des riches contributions réunies dans ce livre, ce qui m’a frappée est le souci de penser à la fois la force de l’interdit de l’inceste et la fréquence longtemps sous-estimée de sa transgression. Dans cette perspective, les chapitres multiplient les éclairages sur les difficultés de la parole, que les victimes ne parviennent pas à parler, qu’on leur ferme la bouche, qu’elles se confient mais ne soient pas entendues, que règne dans l’entourage une forme de « tout le monde savait » décourageant toute révélation publique, qu’elles déposent une plainte bientôt classée sans suite ou encore que, lors d’une procédure judiciaire, le « parole contre parole » aboutisse à un non-lieu ou une relaxe.
Cependant, ce livre montre aussi que rien de tout cela n’est une fatalité. Les victimes d’inceste ont trouvé ces dernières décenn
