L’inceste comme atteinte au langage (2/2)
Celui qui commet l’inceste porte toujours atteinte à la fois à autrui et au langage : il ne porte pas seulement atteinte au « corps » de cette personne, ni même à son « moi » ; il porte atteinte à sa vie d’humain, à son inscription primordiale dans la parenté, à son droit originel de participer du monde humain comme monde de significations communes.
À partir de là, l’extrême gravité de la violence subie par l’enfant victime d’inceste peut être mieux comprise, comme le montrent les nombreux chapitres de ce livre consacrés à la difficulté pour la victime de parler et, quand elle parle, d’être entendue. Elle est exprimée avec force dans le très beau texte d’Hervé Bréhier qui n’utilise que les mots saisissants de « géniteur » et de « rejeton » pour signifier l’inceste dont il fut victime enfant.
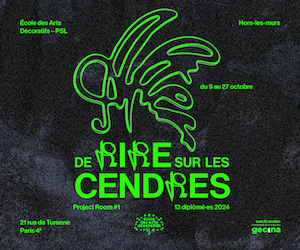
En cas d’inceste, il y a destruction des places relationnelles de père et de fils. L’incesteur, qu’il soit par exemple père, beau-père, ou grand-père, agit en tant qu’ascendant tout en refusant ce que le lien de parenté veut dire[1]: il déclare non seulement que l’interdit n’est pas interdit (il se donne le droit de coucher) mais que l’impossible est possible (il décide du sens des mots). Il porte le mensonge au-delà de tout. Et il le fait de surcroît en violant l’enfant, car celui-ci, comme l’a montré Neige Sinno dans son terrible et magnifique Triste tigre[2], n’est jamais en situation de consentir à l’inceste. Non seulement il est trop jeune, mais il est pris dans une relation à la fois d’autorité et de pouvoir, qui ôte tout sens à la notion de consentement.
Là est le cœur de la violence incestueuse, et c’est en ce sens qu’on peut parler d’un acte de domination extrême tout à fait spécifique. Il n’est pas l’aboutissement ultime d’un « continuum de violences » (comme dans le féminicide), mais passe au contraire par un franchissement très particulier de la ligne symbolique de séparation radicale des corps en matière de relation sexuelle au sein de la famille. L’enfant
