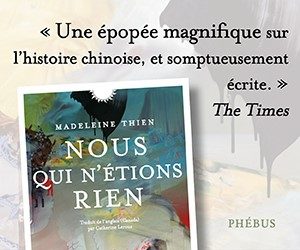Algérie : le spectre du scénario égyptien
Depuis le début des manifestations en Algérie contre le 5e mandat, puis la prolongation du mandat actuel du président Abdelaziz Bouteflika, l’armée se fait discrète.
Figure visible de la grande muette algérienne, le chef d’État major et vice-ministre de la défense, Ahmed Gaid Salah, s’est montré particulièrement avare de commentaires, jusqu’à cette intervention remarquée du 5 mars. Le général algérien y affirmait que l’armée nationale populaire « garantirait la sécurité du pays » et ne permettrait pas un retour à la violence et aux effusions de sang.
Certains groupes, ajoutait le responsable militaire sans donner plus de précision, cherchent à plonger à nouveau l’Algérie dans « les années de douleur », référence explicite à la décennie noire du terrorisme qui frappa le pays au cours des années 1990 et coûta la vie à plus de 200 000 Algériens. Des propos surprenants, dans le contexte d’une mobilisation populaire aussi calme et que massive.
De douleur, il ne fut en effet point question vendredi 15 mars en Algérie, où les manifestations populaires ne sont pas essoufflées. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues d’Alger. A chaque carrefour, les scènes de liesses, danses et manifestations de joie diverses se succédaient dans l’enthousiasme général. Et le soir venu, comme chaque fin de semaine, une question, une seule : Et maintenant ? Qu’adviendra-t-il demain ? La semaine prochaine ? Dans un an ? Personne, en Algérie, ne le sait.
Dans ce contexte politique algérien inédit, où la présidence ne semble plus savoir où elle va, où le nouveau premier ministre, Nourredine Bédoui, raillé par la rue, ne paraît pas en mesure de seconder un pouvoir algérien qui prend l’eau de toute part, et face à l’inertie d’une opposition digérée, vidée de son poids par un système politique exsangue, le spectre de l’intervention militaire plane toujours au-dessus des débats. Avec en filigrane, la même interrogation : quel est le poids politique de l’armée