Alain Guiraudie : « Nous ne sommes plus les mêmes mais nous venons de là »
Très remarqué au Festival de Cannes malgré son confinement dans une section parallèle, le septième-long métrage d’Alain Guiraudie, Miséricorde, sort dans les salles françaises le 16 octobre. Inspiré comme le précédent de certains éléments de son copieux roman Rabalaïre, mais dans une tonalité très différente de Viens je t’emmène (2022), le film renoue avec les terres natales du cinéaste, un village de l’Aveyron, et plus généralement ce Sud-Ouest rural auquel il demeure très attaché.
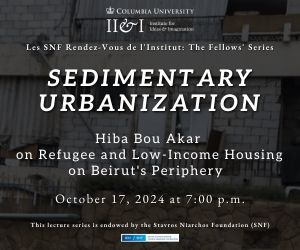
À l’occasion du décès de son ancien patron, le boulanger du lieu, un homme, Jérémie (Félix Kysyl), revient au village où il a grandi. Son arrivée est le point de départ d’une multiplicité d’attirances, de souvenirs, d’affrontements et des rapprochements entre lui, la veuve (Catherine Frot), son fils (Jean-Baptiste Durand), un voisin (David Ayala), le curé du village (Jacques Develay), puis le gendarme qui enquête sur la disparition du fils (Sébastien Faglain). Dans les couleurs d’un automne somptueux et les noirceurs de nuits propices à de multiples secrets, avec un humour aussi ravageur que pince sans rire, Guiraudie déploie les puissances sensuelles et critiques de son cinéma. Celui-ci s’inscrit désormais dans un ensemble de pratiques artistiques où figure également la littérature, avec les romans Ici commence la nuit, Rabalaïre et sa suite, Pour les siècles des siècles, tous chez P.O.L, et également la photographie.
Miséricorde est le nouveau joyau modeste et inoubliable d’une œuvre qui, depuis les moyens-métrages Du soleil pour les gueux et Ce vieux rêve qui bouge en 2001, puis le long Pas de repos pour les braves (2003), et avec ces sommets qu’ont été Le Roi de l’évasion (2009), L’Inconnu du lac (2013) et Rester vertical (2016), s’impose titre après titre comme une des plus inventives et nécessaires du cinéma français de ce premier quart de siècle. Vibrant d’une réjouissante manière de transformer le quotidien en mystère, aux confins de l’érotisme et du mysticisme, le film
