L’accumulation des preuves – sur Archipels d’Hélène Gaudy
Un homme disparaît : la formule, transposée du célèbre film d’Alfred Hitchcock, dit le discret mouvement d’effacement qui emporte doucement le père d’Hélène Gaudy et suscite l’urgence d’en dresser le portrait. À la manière d’une île de Louisiane, qui porte le prénom de son père, et s’enfonce chaque jour davantage, cette silhouette familiale s’estompe et s’éloigne dans le mystère.
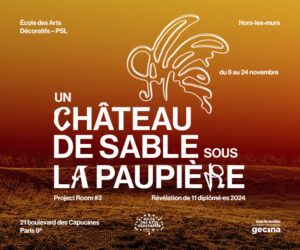
Dans cette comparaison initiale, l’imaginaire marin de l’écrivaine trouve à se déployer : de Vues sur mer à Un monde sans rivage, en passant par Une île une forteresse, un sillon maritime parcourt l’œuvre et une fascination ambivalente pour le motif de l’île. Si l’extraction pétrolière, l’érosion marine et les effets de l’anthropocène rendent vain le désir de sauver cette île de Louisiane du naufrage, il est temps encore de sonder le mystère d’un individu, d’empoigner son existence sous la surface de sa discrétion, pour reconstituer le parcours de celui qui comme Georges Perec dit n’avoir pas de souvenir d’enfance.
Enquêter sur ses parents, dessiner des généalogies lointaines, rendre hommage à des figures oubliées de l’album de famille, c’est devenu un genre littéraire : le récit de filiation, selon le terme proposé par Dominique Viart. Mais de tels portraits de famille s’écrivent la plupart du temps depuis la mort des ascendants et le livre compose alors une manière de tombeau, pour inscrire pour mémoire et faire hommage. Si Archipels d’Hélène Gaudy constitue bien un récit de filiation, composant par éclats et facettes le portrait d’un père, il s’élabore à rebours de La place d’Annie Ernaux ou de Vies minuscules de Pierre Michon, dans le dialogue vivant avec son père, qui lui confie des carnets, lui ouvre grand son atelier, permet à l’écrivaine d’avoir toutes les pièces en main pour reconstituer le puzzle d’une identité.
Mais composer avec le vivant n’est sans doute pas plus facile que d’avoir à recomposer les linéaments d’une silhouette lointaine : c’est ce paradoxe qui est le
