Le mot race – Le mot et la chose (2/2)
Dans l’espace public en France, il y a aujourd’hui un paradoxe fondamental. D’un côté, il n’est question que de racisme ; de l’autre, il n’est pas question de parler de race. Autrement dit, on a la chose mais pas le mot pour la penser. Mais le paradoxe redouble : quiconque utilise le mot race, même en revendiquant des fins antiracistes, serait, sinon coupable, du moins comptable de cette poussée raciste. Autrement dit, c’est opposer le mot à la chose. On peut dès lors s’interroger : pour échapper à ce piège, pourquoi ne pas, tout simplement, remplacer race par racisme ?
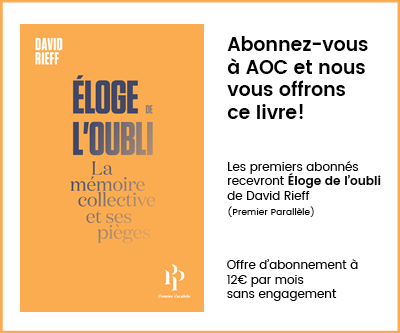
En réalité, force est d’admettre que le problème tient à la définition de la chose plus qu’à l’usage du mot. Partons d’un syllogisme. Dans le monde universitaire, comme dans les médias, tout le monde (ou presque) est antiraciste ; et pourtant, tout le monde (ou presque) est blanc. Comment conclure au racisme, sans contredire la prémisse majeure d’antiracisme ? C’est ici qu’on voit l’utilité du concept de race. Il sert à penser la contradiction inscrite, non pas dans ce raisonnement, mais dans notre société.
On comprend dès lors la difficulté actuellement rencontrée pour s’accorder à juger raciste, ou non, telle pratique, tel discours ou telle représentation, selon qu’on aborde la question en termes de race, ou pas. Dans l’actualité, songeons par exemple aux controverses récurrentes sur le blackface. Dans le débat public, la plupart reconnaissent désormais que cette pratique relève du racisme – mais en ajoutant : si et seulement si l’intention en est raciste. Autrement dit, c’est continuer d’écarter la définition du racisme par ses conséquences, dans une société où l’on peut jouer au Noir quand on est blanc, mais pas jouer au Blanc quand on est noir. Les protestations des activistes sont alors récusées comme le signe de leur inculture (« ils ne comprennent pas l’art ! ») ou d’une intolérance qui menace la liberté d’expression (« ils ne respectent pas l’art ! »). Tout se passe comme si, jusque dans le
