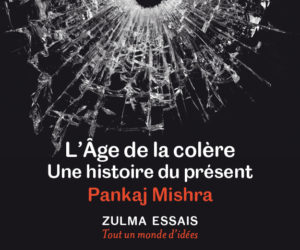Une crise de la parole
Lorsqu’un responsable politique appartenant au Rassemblement National se trouve devant un contradicteur qui lui met devant les yeux que son affirmation précédente est un mensonge et non un fait, il répond : c’est mon opinion. C’était à propos des accords de Marrakech et c’est rapporté au cours de l’émission « C à dire » que je n’ai pas de raison de remettre en question.
Lorsque Laurent Wauquiez affirme devant les étudiants de l’école de commerce EM Lyon que ce qu’il dit à la télévision est « bullshit », on s’en émeut, mais on passe. Et lui continue à parler. Les réseaux sociaux sont envahis de fake news, de ragots complotistes, de rumeurs énoncées sans preuves ni fondement. La réalité des faits s’absente. Et la parole qui les rapporte peut divaguer.
La démocratie est d’abord un régime de la parole. Dès son origine, dans l’Athènes du Ve siècle av JC, la démocratie se fonde sur l’échange de la parole. Dès son origine, le rapport conflictuel de la politique et de la vérité se joue, là, sur l’espace public. Socrate ne cesse de le rappeler aux rhéteurs : attention, convaincre peut ne pas répondre de la vérité. La rhétorique ne permet pas d’accéder au monde des Idées. Lorsqu’il s’agit de déterminer quelles sont les vertus qui justifient de prétendre à la direction des hommes, Socrate, dans son dialogue avec Alcibiade, bute sur la difficulté – quelle est donc cette excellence qui permettrait de régler les relations entre les hommes ?- et fait appel à un tiers, un dieu dont l’existence n’apparaît pas dans le panthéon grec, ce que d’ailleurs les grecs ne lui pardonneront pas.
Aristote, dans l’éthique à Nicomaque, prend acte : « Dieu, écrit dans un livre aujourd’hui ancien, est désormais caché ou muet, l’homme ne doit plus compter que sur ses seules forces pour organiser sa vie terrestre » (voir Pierre Aubenque). Si Platon fait de la connaissance de l’Idée de Bien le fondement de la vie politique, Aristote sépare la théorie et la pratique. La politique serait orphe